Robert Bourasse a parlé. « Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse… ». C’est la veillée funèbre de l’accord du Lac Meech, le 22 juin 1990. Devant lui, Jacques Parizeau se lève. Un discours bref, ni triomphal (je vous l’avait bien dit), ni dénonciateur (dans quel pétrin vous nous avez mis), ni partisan (vous avez échoué, démissionnez). Plutôt, des phrases d’ouverture, des mots de compatriotes, une proposition d’avenir.
Pour souligner les 20 ans de la mort de l’accord du lac Meech, il me fait plaisir de vous présenter, en feuilleton, des extraits du premier chapitre de mon livre Le tricheur, qui relate comment les acteurs politiques québécois ont vécu la mort de l’accord.
Indépendamment des querelles que nous avons pu avoir, indépendamment des accusations que nous avons pu nous porter, indépendamment de ce que nous avons pu nous dire et qui, de temps à autre, pouvait être très blessant, alors je dis, M. le Président [de l’Assemblée], à mon premier ministre : Essayons de nous retrouver.
Il faut que nous puissions trouver une autre voie, puisque celle qu’il avait choisie se révèle être un cul-de-sac. Et je dis, M. le Président, à mon premier ministre : Je vous tends la main.
Cherchons, cet automne, tous ensemble, une voie de l’avenir du Québec.
Pourquoi ce geste? « J’ai jamais cru, moi, que le Québec pouvait retirer un avantage quelconque d’être faible ou par terre, explique Parizeau à l’auteur. Je sais très bien qu’après la nuit des longs couteaux, en 1981, dans quelle situation nous comme gouvernement on était placé. On était écrasé. Ça m’a beaucoup frappé, cet épisode là. Et quand, après Meech, il était clair que le premier ministre du Québec lui aussi était écrasé, ça me paraît presque nécessaire sur le plan de l’intérêt public [de faire un geste]. Quel que soit le premier ministre du Québec, c’est jamais bon qu’il soit par terre ». Et puis, ajoute-t-il, « les gens ont horreur qu’on cogne sur quelqu’un qui vient de perdre ».
Le 22 juin, Jacques Parizeau ouvre une parenthèse inédite dans l’histoire des relations partisanes québécoises. Celle dite « de la main tendue ». Le lendemain, au Salon rouge, Robert Bourassa le remerciera « de la manifestation de solidarité dont il a fait preuve hier soir. Le Québec est toujours plus fort quand il est uni ». Le geste de Parizeau n’était ni facile, ni évident, ni spontané. Il était l’aboutissement d’un cheminement entrepris huit mois plus tôt dans la mauvaise humeur.
Au soir des élections provinciales du 25 septembre 1989, Jacques Parizeau n’est pas fier des électeurs québécois. Surtout de ceux qui n’ont pas voté pour lui. « Je suis en hostie », souffle-t-il à un proche, alors que les écrans de télévision annoncent la victoire de Robert Bourassa et de son équipe, et la portion congrue laissée aux députés péquistes, 29 sièges seulement, malgré leur résultat de 40%. « Comment ont-ils pu faire ça? », dit-il encore, parlant des Québécois. « Pourquoi ne comprennent-ils pas? » peste-t-il devant plusieurs témoins.
Parizeau revenait de tellement loin et avait franchi une telle distance qu’il avait cru pouvoir atteindre le but du premier coup. Quand il avait pris la direction du Parti Québécois, en mars 1988, c’était comme s’il s’était présenté à une vente de faillite. Sonné par la défaite référendaire de 1980, l’usure de neuf ans de pouvoir, le schisme provoqué par le « beau risque » de René Lévesque en 1984, la défaite électorale en 1985, l’incessante querelle entourant ensuite le leadership de Pierre Marc Johnson, le recul de l’idéal souverainiste dans l’opinion, puis la perspective, en 1987, d’un accord de Meech consacrant la place du Québec comme « société distincte », le parti s’était effondré.
Remis en selle, le PQ pense pouvoir faire bonne figure à l’élection de 1989. À un tournant, il n’est plus qu’à 4% du PLQ. Parizeau se met à croire la victoire possible, probable même. Le coup est classique : contents de la performance de leur chef, ses stratèges se gardent de trop l’informer des ratés de la machine, surtout dans les circonscriptions où le travail de réparation des avanies partisanes encore récentes est loin d’être terminé.
Au soir de l’élection, Parizeau rage d’autant plus qu’il sent déjà venir la fronde canadienne-anglaise et qu’il prévoit que Meech va s’écrouler – il l’a déclaré « mort » pendant la campagne -, entraînant à la fois une crise gigantesque et une occasion historique. Il jure encore contre les Québécois qui ont encore choisi pour chef un frileux comptable alors qu’il fallait un rigoureux radical. Il rage donc, pour reprendre les mots de Gaston Miron, contre « ce pays qui n’en finit pas de ne pas naître ».
Après la défaite, le comité de stratégie du PQ se réunit, comme chaque lundi matin. C’est là que réside le vrai pouvoir péquiste. Là, bien plus qu’au caucus ou qu’à l’exécutif, dont les membres s’en plaignent d’ailleurs souvent. Le comité est constitué d’abord du chef, bien sûr. À ses côtés, le vice-président, Bernard Landry, le député Guy Chevrette, et trois conseillers : Jean Royer, Hubert Thibault et Pierre Boileau.
Dans les mois qui suivent l’élection de septembre 1989, Parizeau et son comité font un pari : Meech ne passera pas. « J’ai monté toute ma stratégie sur l’hypothèse que Meech va échouer », explique Parizeau. « Je me targue de connaître un tout petit peu le Canada anglais. » Mais il fallait un peu aider Meech à échouer, pour autant que le PQ ait quelque pouvoir à cet égard. Deux pressions contradictoires sont exercées.
La première, à l’Assemblée nationale, pour forcer Bourassa à tenir fermement à l’Accord tel quel, à « le renchausser » comme dit Parizeau, pour qu’il n’accepte aucun des compromis qui accommoderait le Canada anglais. Mission accomplie : une résolution bipartisane de l’Assemblée nationale, le 5 avril 1990, réaffirme la volonté du Québec de faire adopter l’accord du Lac Meech dans son intégrité.
La seconde, au Canada anglais, pour l’inciter à dire non. « On a tout fait pour provoquer le Canada anglais pour pas qu’ils n’acceptent Meech », avoue un membre du comité de stratégie. Parizeau va notamment s’ouvrir à Barbra Frum, de l’émission-phare de la CBC The Journal, de son intention, s’il prend le pouvoir, d’utiliser Meech au maximum pour rendre le Québec de plus en plus distinct, et informe les téléspectateurs que l’Accord n’est qu’un débat dans l’interminable combat québécois pour obtenir encore plus de responsabilités. C’est tout à fait exact et Bourassa ne dit pas le contraire. Mais de voir Parizeau, un séparatiste, poser un jugement entre deux ricanements satisfaits, cela a de quoi donner la nausée aux mieux disposés des meechistes anglophones. « Pour que la Canada signe pas ça, il fallait que Parizeau fasse ces sorties là » précise le stratège.
Tout allait bien pour la stratégie péquiste pendant le printemps 1990. Le 6 juin, Pierre Boileau réunit dans les locaux du parti quatre alliés de la mouvance souverainiste pour préparer la grande parade de la Saint-Jean. Ils décident d’un slogan pour le défilé : « Notre vrai pays, c’est le Québec. » Quelle n’est pas leur surprise, le 9 juin a soir, de constater que 11 premiers ministres, réunis à Ottawa, resignent un document adoptant Meech et d’entendre Bourassa lancer la phrase : avec Meech, « pour tous les Québecois, le Canada sera un vrai pays ». Boileau lance un « Tabarnak! On est buggés au parti! »
Au-delà de cet emprunt de slogan, le PQ a un problème de taille : tel Lazare, Meech renaît. « Là, j’ai une alerte chaude », admet Parizeau. « On a l’impression que c’est sur le point d’aboutir. Dans mon entourage, on est extraordinairement nerveux! Mon hypothèse est en train de s’écrouler. » Tels les pleureuses italiennes, des membres du caucus l’implorent : « Mais si Meech passe, de quoi on aura l’air? ». Néanmoins, Parizeau maintient le cap. « Six jours avant l’étape ultime, je le sais que ça ne marchera pas, dit le chef péquiste. Comme tout le monde, je veux simplement savoir pourquoi ça ne marchera pas, ou comment. »
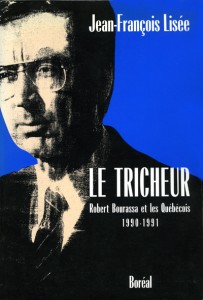 Le 22 juin, dans le salon des parlementaires attenant à l’Assemblée nationale, il assiste sur les écrans à la mort de Meech. Bourassa n’a pas cédé (ou si peu), le Canada non plus, tout le monde a joué le rôle prescrit pas le chef péquiste. L’occasion historique peut maintenant survenir. Parizeau peut tendre la main.
Le 22 juin, dans le salon des parlementaires attenant à l’Assemblée nationale, il assiste sur les écrans à la mort de Meech. Bourassa n’a pas cédé (ou si peu), le Canada non plus, tout le monde a joué le rôle prescrit pas le chef péquiste. L’occasion historique peut maintenant survenir. Parizeau peut tendre la main.
(Demain : Le PQ dans le piège de Bourassa)

