 Parizeau a tendu la main. Il a son parti derrière lui. Ce n’était pas évident. Depuis plusieurs mois, alors que se jouait l’agonie de Meech et qu’émergeait dans l’opinion un sentiment souverainiste pour la première fois nettement majoritaire, le PQ se heurtait à un mur : le calendrier politique.
Parizeau a tendu la main. Il a son parti derrière lui. Ce n’était pas évident. Depuis plusieurs mois, alors que se jouait l’agonie de Meech et qu’émergeait dans l’opinion un sentiment souverainiste pour la première fois nettement majoritaire, le PQ se heurtait à un mur : le calendrier politique.
Bourassa ayant été élu en 1989, il tient le pouvoir jusqu’en 1994 s’il le veut. Vague souverainiste ou pas, le PQ est condamné à attendre. Et pendant ce temps, le nombre de souverainiste croît jour après jour, dans l’opinion, chez les hommes d’affaires, dans le caucus libéral, chez les ministres, même.
Pour souligner les 20 ans de la mort de l’accord du lac Meech, il me fait plaisir de vous présenter, en feuilleton, des extraits du premier chapitre de mon livre Le tricheur, qui relate comment les acteurs politiques québécois ont vécu la mort de l’accord.
Que faire? Au comité de stratégie du lundi et au caucus, des voix s’élèvent dès le début du printemps 1990 : tendre la main aux libéraux. Cette opinion est d’abord minoritaire. Au comité de stratégie, c’est le conseiller Pierre Boileau qui mène d’abord ce combat. Il a un livre de chevet : une étude en profondeur préparée en 1984, appelé Motivation et résistance face à l’indépendance.
Une de ses conclusions : les Québécois, comme Bourassa, n’aiment pas « le trouble ». Si les deux partis, plutôt qu’un seul, étaient bien disposés envers la souveraineté, l’opinion « débloquerait », un verrou sauterait et la vague monterait.
Boileau a intégré ces données. Il pousse sa stratégie au comité. « La politique de main tendue fait avancer l’idée de la souveraineté, parce que les gens sont moins insécures de cette façon-là », dit-il. Au caucus, deux députés se font les défenseurs de cette thèse. Deux députés pourtant jugés « purs et durs » : Louise Harel et Michel Bourdon, d’anciens époux devenus complices. C’est justement parce qu’ils veulent la souveraineté par-dessus tout qu’ils sont prêts à la faire faire par d’autres. Denis Lazure, un vétéran, est dans leur camp.
Au printemps, le débat fait rage. Plusieurs s’opposent à cette idée. Jacques Léonard et Jean Garon font de la résistance. Bernard Landry, aussi, qui « trouvait ça effrayant que le Parti libéral fasse l’indépendance ». Plusieurs débats s’enchevêtrent, car il y a ceux qui ne veulent pas de cette stratégie, et il y a ceux qui n’y croient pas. Boileau leur affirme que le PQ joue gagnant dans tous les cas : « Bourassa va tout faire pour éviter la souveraineté, leur dit-il. Mais s’il la fait, tant mieux! » Tant mieux pour le référendum sur la souveraineté, qui pourrait attirer 75% des votes. Tant mieux pour les coûts de transition, qui seraient beaucoup moindres.
Mais pour Bernard Landry, c’est presque une question de tripes, raconte un témoin. « Il voyait Claude Forget [ancien ministre fédéral] ambassadeur à Paris, puis les libéraux qui mettent en place tout leur appareil à eux. « Ils ont combattu la souveraineté toute leur vie, » disait-il. Il était pas capable de voir ça. »
Ni de le concevoir. Lorsque, au printemps 1990, le démographe Georges Mathews publie un livre de politique-fiction, L’Accord. Comment Robert Bourassa fera l’indépendance, Landry trouve la chose loufoque. Mais de débat interne en débat interne, le vice-président du PQ finit par se ranger à l’opinion des Boileau, Harel et Bourdon. Si le PLQ veut la faire, aidons-le. Et tant pis pour l’ambassade de Paris.
À Alma, le 20 mai, le PQ tient son Conseil national (plus haute instance entre les congrès). Le 20 mai, donc 10 ans après le référendum de 1980. C’est là que Parizeau lit la lettre du « ministre » fédéral conservateur Lucien Bouchard, qui ne sera plus ministre 48 heures plus tard. C’est là aussi que se fait le débat de la main tendue. Bernard Landry en devient un des meilleurs défenseurs. « S’ils veulent la faire, nous la ferons avec eux », déclare-t-il. C’est un peu comme si le PQ acceptait de donner sa raison d’être à son vieil adversaire, du moins de la partager avec lui. « La phrase clé de l’époque, résume Landry, c’était La patrie avant les partis. »
Des membres du caucus péquiste abordent aussi leurs collègues libéraux nationalistes, pour répandre la bonne nouvelle. « Les députés péquistes, je devrais vous dire, que peu importe avec qui ils la feraient, ils voulaient la faire », se souvient Jean-Guy Lemieux, député libéral de Québec, approché par plusieurs collègues de l’opposition. D’autres cependant lui semblaient « sceptiques, ils avaient des doutes » sur la réelle volonté de Bourassa. Lemieux se souvient que Lazure et le député André Boisclair, entre autres, lui ont dit : « On est prêts à vous suivre dans ce sens-là. »
La mort de Meech amplifie cette volonté bipartisane. Plusieurs qui y avaient adhéré par conviction souverainiste et par tactique deviennent de véritables convertis. Premier d’entre eux : l’ex-sceptique Bernard Landry. Avec le « quoi qu’on dise… », il craque. « Là, Bourassa a été assez raide dans les heures qui ont suivi » la mort de Meech, rappelle Landry. « En disant que le Québec est une société distincte pour toujours et ainsi de suite, moi j’ai pensé, là, sérieusement, que Robert Bourassa venait, après 25 ans d’hésitation, de se rendre à nos arguments et qu’il allait tranquillement s’orienter vers la souveraineté du Québec en se ménageant de l’espace de virage. »
Landry a le réflexe d’appeler Louis Bernard, l’ancien bras droit de Lévesque qui venait de vivre le sprint de Meech à Ottawa en compagnie de Bourassa. Landry, comme beaucoup de décideurs québécois, a beaucoup de respect pour la capacité d’analyse de Louis Bernard. C’est le contraire d’un excité. Il résiste aux modes et aux enthousiasmes. C’est pourquoi le numéro deux du PQ le croit lorsque Louis Bernard lui dit au bout du fil : « Là je crois que Bourassa va cheminer vers la souveraineté. » (Louis Bernard ne se souvient pas d’avoir été aussi définitif, mais presque : « Si j’ai dit ça, c’est un résumé, dit-il. Tout son parti [libéral] et le Québec dans son ensemble allaient dans ce sens-là, alors je pensais que Bourassa aurait cheminé lui-même là-dedans. »)
Que peut bien dire Robert Bourassa, en privé, aux souverainistes qu’il rencontre, comme Louise Bernard, Claude Béland, Lucien Bouchard et autres, pour qu’ils sortent convaincu que la souveraineté est sur son écran radar ? Sans doute des propos proches de ceux qu’il tient devant l’enregistreuse de l’auteur, en 1991:
L’objectif de souveraineté est peut-être un des plus nobles. Mais moi, ce que j’ajoute à ça, c’est qu’on ne le réalise pas en démantelant allègrement le Canada. Mais si le Canada — on a l’impression un peu comme Sisyphe, on fait des propositions,ça marche jamais — si le Canada lui-même refuse toute rénovation du fédéralisme, à ce moment-là on ne peut pas nous reprocher de quitter et de faire la souveraineté.
Bernard Landry, vice-président du PQ, plante donc profondément son pavillon dans le camp du rêve. Fini les inquiétudes sur le partage des ambassades. « Nous voulons la souveraineté plus que toute autre chose dans notre vie publique, explique-t-il, plus que le pouvoir, plus que de dire : « C’est nous qui l’avons fait! » » Et il se répand dans les salons avec cette phrase : « Dans une république du Québec souverain, il y a un président et un premier ministre. » Sous-entendu : que Bourassa choisisse son titre, nous prendrons l’autre.
Mais Parizeau, dans tout ça? Dans les débats précédant la mort de Meech, « il est en réserve », se souvient Bourdon. Aux réunions du lundi matin, « il parlait pas dans ces affaires-là, il écoutait, raconte un stratège. Il écoutait avec un petit sourire. »
« Moi, affirme Landry, je me souviens très bien que j’ai rapporté à Parizeau les paroles de Louis Bernard, et je les ai rapporté à plusieurs reprises. Moi qui avais tendance à croire Louis Bernard, je voyais Parizeau très sceptique. »
Que pensait-il? Quand l’auteur lui demande, trois ans après le fait, s’il jugeait que Bourassa ferait la souveraineté Parizeau répond comme s’il s’agissait d’une gigantesque blague. Le chef péquiste fait un peu de surimpression historique. En janvier 1991, devant des journalistes du Soleil, il jongle tout haut avec cette possibilité :
Quand on a été 20 ans en politique, comme M. Bourassa, dont 11 ans comme premier ministre, on doit vouloir laisser son nom dans l’histoire. [Ce doit être] une remarquable tentation pour M. Bourassa [qui] ne voudra peut-être pas être celui qui a approché d’une solution, puis a laissé simplement derrière lui le bordel et le chaos.
Au printemps de 1991, en entrevue avec Jacques Godbout, Parizeau confirme y avoir songé :
Je me disais : peut-être est-ce que vraiment ils accepteraient de s’embarquer dans un référendum de la souveraineté?
Puis, à l’auteur, à l’automne de 1991, il déclare :
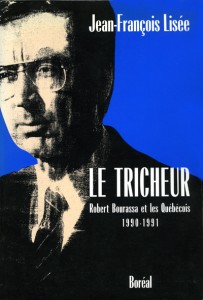 J’ai jamais été persuadé, absolument, que M. Bourassa accepterait un jour de faire la souveraineté. Peut-être, mais loin d’être certain. C’est un nationaliste. Est-ce qu’il aurait été jusque là? Je ne sais pas. Est-ce que le fait de lui tendre la main pouvait l’amener un peu davantage? Peut-être.
J’ai jamais été persuadé, absolument, que M. Bourassa accepterait un jour de faire la souveraineté. Peut-être, mais loin d’être certain. C’est un nationaliste. Est-ce qu’il aurait été jusque là? Je ne sais pas. Est-ce que le fait de lui tendre la main pouvait l’amener un peu davantage? Peut-être.
À l’été de 1990, après la mort de Meech, Parizeau, comme le reste de son parti, fait en quelque sorte le pari politique de Pascal. Si Bourassa-le-souverainiste existe, leur vœu sera exaucé. S’il n’existe pas, qu’auront-ils perdu à essayer?
(Demain: La grande parade des députés fédéraux)
