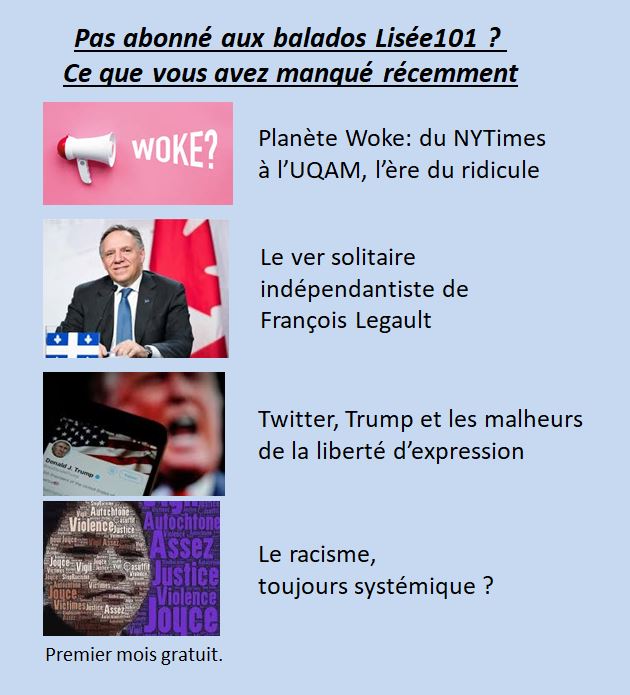Les archives parlent ! Des dépêches diplomatiques récemment déclassifiées révèlent que Pierre Trudeau et son ami financier Paul Desmarais discutaient de saboter économiquement le Québec dans les semaines suivant l’élection surprise du Parti québécois en novembre 1976.
Pierre Trudeau l’évoque directement avec l’ambassadeur américain Tom Enders, qui prend des notes. Paul Desmarais en dévoile encore davantage dans sa propre rencontre avec l’ambassadeur, affirmant que « l’idée serait de faire monter le chômage au Québec, de 10% actuellement, à 15 voire 20% d’ici un an ». Ce plan, de toute évidence, n’a pas été mis à exécution.
Il est vrai que, pour au moins un an, il y a eu à Wall Street l’équivalent d’un boycott du Québec. Personne ne souhaitait acheter des obligations du Québec ou d’Hydro-Québec. Il n’y a pas de trace d’un rôle quelconque joué par le gouvernement canadien ou la diplomatie canadienne dans ce boycott, ce qui n’est pas exclu.
J’avais interviewé Enders pour mon livre Dans l’oeil de l’aigle (épuisé en librairie, disponible ici et en format PDF). Comme on le verra dans cet extrait, Enders est intervenu auprès de gens d’affaires américains pour les inciter à ne faire aucune déclaration qui puisse aider René Lévesque et sa cause. Il affirme cependant être intervenu auprès d’investisseurs américains au Québec pour les inviter à ne pas réduire leurs investissements.
Au-delà de ces éléments fort intéressants, les premiers contacts Trudeau-Enders se déroulent sur fond d’une crainte réelle que les Américains soient tentés, non d’en faire trop pour aider Trudeau, mais de donner un coup de pouce aux indépendantistes, pour faire avancer leur propre intérêt.
Le récit montre combien l’élection du PQ a forcé Trudeau, jusque alors très peu intéressé par les États-Unis, à faire les yeux doux à l’Oncle Sam.
Angoisse au 24 Sussex
«Il n’est pas un homme d’État américain
qui ne désire s’approprier le Canada.»
– John A. Macdonald
Les Américains? «Ce qu’ils ont, ils le gardent,
et ce qu’ils n’ont pas, ils le veulent.»
– Wilfrid Laurier
15 novembre 1976. L’événement contre lequel Pierre ElliottTrudeau œuvre depuis son entrée en politique s’est produit. Six mois après qu’il eut proclamé la «mort du séparatisme», le Québec lui fait un énorme pied de nez. Le vieux frère ennemi, René Lévesque, est porté au pouvoir. La surprise est presque générale. Elle n’arrive pas seule. Avec elle, se faufile sa compagne de route: la peur.
Trudeau, Lévesque, ces deux incarnations du destin québécois, la ressentent de part et d’autre de l’Outaouais, aujourd’hui un peu plus large, un peu plus tumultueuse que la veille.
Au moment de monter sur l’estrade pour avouer à ses partisans pleurant de joie que, cette victoire, «on l’espérait de tout notre cœur mais on l’attendait par comme ça cette année», René Lévesque semble assommé par la gravité du processus qu’il a mis en branle. Pendant un bref instant, raconte la journaliste Joan Fraser qui l’observe à quelques pas de distance, son visage trahit une vraie, profonde et paralysante peur.
À Ottawa, au lendemain du tremblement de terre politique québécois, quelqu’un lit sur le visage de Pierre Trudeau l’image inversée de cette même émotion.
Trudeau, «angoissé», «inquiet», dit le témoin, se demande si les Américains s’empareront de la victoire péquiste comme d’une occasion de «redessiner les frontières de l’Amérique du Nord». S’ils comptent s’approprier, donc, les futurs lambeaux d’un Canada déchiqueté. «À l’évidence, il craignait que les États-Unis ne jugent pas que le maintien de l’unité canadienne soit nécessairement dans leur intérêt», se souvient ce témoin, l’ambassadeur américain à Ottawa, Thomas Enders.
Et si le premier ministre du Canada a invité le représentant de la superpuissance voisine à son bureau dans les trois jours qui suivent la victoire péquiste, c’est qu’il comprend n’avoir une chance de reprendre l’initiative qu’on lui a si brutalement arrachée la veille que dans la mesure où les sécessionnistes, maintenant maîtres du Québec, ne bénéficient pas des encouragements de l’Oncle Sam.
Il pose la question. «Les États-Unis jugent-ils vraiment dans leur intérêt que le Canada reste uni?» L’ambassadeur Enders, jeune star — il a 45 ans — de la diplomatie américaine, ne connaît pas la réponse. Il promet de se renseigner, de quérir des instructions.
Pierre Trudeau n’est pas le seul fédéraliste à craindre la formation d’un axe Washington-Québec. Dans les jours qui suivent l’élection, les deux hommes d’affaires les plus puissants du Canada, le président de Power Corporation, Paul Desmarais, et le président du Canadien Pacifique (et directeur de 23 autres compagnies), Ian Sinclair, viennent partager chez Trudeau leurs premières impressions de la défaite. Broyer un peu de noir. Ils conviennent avec lui qu’il faut s’assurer que Washington choisisse le bon camp. Le premier ministre leur demande d’aller faire eux-mêmes un petit pèlerinage chez l’Américain.
Devant Enders, Desmarais et Sinclair plaident, non la cause du Canada, mais les arguments qui veulent que les États-Unis ne puissent se passer d’un voisin stable, fort, uni. L’ambassadeur est un tantinet surpris de cette offensive. «Je pense qu’il y avait beaucoup de Canadiens qui n’étaient pas certains de la manière dont nous allions réagir.»
La visite des deux hommes «m’a permis d’obtenir des informations utiles sur les vues de la communauté des affaires à cet égard», dit-il, comme s’il y avait eu le moindre doute sur le fédéralisme des hommes d’affaires canadiens.
Desmarais et Sinclair repartent, comme Trudeau, bredouilles. L’administration américaine, en ce mois d’élection présidentielle, est à cheval entre le chef d’État défait, Gerald Ford, et l’inconnu au large sourire qui a pris le pays comme une tornade, Jimmy Carter. Presque tous les quatre ans, entre l’élection de novembre et l’intronisation du nouveau président en janvier, les États-Unis demandent à la planète de patienter. Le sort du Canada ne fait pas exception.
Guatemala 1954, Canada 1976?
Trudeau craint de trop bien savoir ce que les Américains ont dans leur manche. Lui qui a mis la politique étrangère canadienne sens dessus dessous depuis son irruption au pouvoir huit ans auparavant, lui qui a reconstruit la vision internationale du pays sur la seule et unique base de «l’intérêt national» canadien plutôt que sur les alliances militaires ou sur les rapports commerciaux existants, redoute aujourd’hui que cette même vision ne revienne le hanter.

Car rien ne lui dit que «l’intérêt national» américain exige la permanence de l’union canadienne. L’Histoire enseigne le contraire. L’actualité le crie.
L’Histoire: Teddy Roosevelt, le dernier d’une série de dix occupants de la Maison-Blanche à désirer ardemment avaler le jeune Canada dans l’insatiable Amérique, n’a quitté son poste que 68 ans auparavant. Son successeur, William Taft, a voulu un traité de réciprocité commerciale dont il était convaincu qu’il «ferait du Canada un auxiliaire des États-Unis». Officiellement, la doctrine de la «destinée manifeste» qui voulait, qui réclamait que Washington étende son pouvoir sur le territoire entier de l’Amérique du Nord, n’a pas trouvé de défenseur parmi les chefs d’État américains du dernier demi-siècle. Mais moins de trente ans avant l’élection du PQ, le premier ministre canadien qui avait le plus fréquenté les présidents américains, Mackenzie King, affirmait à son cabinet qu’il était «convaincu que l’objectif à long terme des Américains était de contrôler le continent», de faire du Canada «une partie des USA».
Il y a dix ans à peine, George Ball, le bras droit du secrétaire d’État américain, dressait dans son bureau les plans d’un État anglophone qui embrasserait le continent, et au-delà. Ce stratège brillant, respecté, continue, en ce milieu des années soixante-dix, de répéter sur les tribunes qu’une union nord-américaine est aussi inévitable que souhaitable.
Combien d’autres George Ball se cachent aujourd’hui parmi les éminences grises des puissants américains, se demandent à Ottawa Pierre Trudeau et certains de ses proches collaborateurs? Et si on trouvait encore hier des Américains prêts à jouer avec ce concept lointain de l’absorption du Canada, combien de vocations annexionnistes fleuriront-elles, maintenant que se présente une occasion réelle, palpable, immédiate de rendre un dernier et final hommage à la destinée manifeste?
L’actualité: depuis le début de la décennie, elle porte un nom. Pétrole. Le premier choc pétrolier a effondré la folle insouciance de l’Occident à l’égard d’une ressource dont on commence à comprendre qu’elle n’est pas inépuisable. Le carburant de la gloutonne et gaspilleuse économie américaine, hier concentré dans des pays, sinon amis, du moins malléables, est aujourd’hui l’instrument d’un cartel international agressif: l’OPEP. Washington, Londres et Tokyo, dans une analyse d’où le racisme n’était pas totalement absent, en croyaient les Arabes bien incapables.
Il y a du pétrole et du gaz en Amérique du Nord. Depuis des années déjà, Ottawa et Washington s’entre-déchirent sur un dossier épineux: celui du gazoduc qui relierait l’Alaska, via le territoire canadien, aux autres États américains. Au-delà des arguties légales, le problème fondamental n’est-il pas la présence d’un pays étranger — le Canada — entre l’Alaska et le Midwest? Une évidence que Trudeau a lui-même soulignée en multipliant par 2,5 le prix du gaz naturel vendu au sud et en réduisant, il y a deux ans, les exportations de pétrole canadien aux États-Unis. Car il y a aussi du pétrole en Alberta, qui en ces années de soudaine fortune se pose plus que jamais la question du profit qu’elle tire de son appartenance à la Confédération canadienne. Il y en a aussi au Manitoba, comme peut-être sur les côtes de Terre-Neuve, sans parler du Grand Nord canadien, dont le sol gelé recèle des réserves qu’il sera bientôt rentable de prospecter.
Teddy Roosevelt pensait que l’Ouest canadien «devrait être entièrement contenu dans nos frontières… moins pour notre propre intérêt que pour celui de ses habitants». Aujourd’hui cet altruisme de façade fait sourire. Le jeûne de pétrole imposé aux États-Unis par l’OPEP et par le Canada pousse les Yankees à se poser la question de toutes les ressources non renouvelables. Combien de minutes leur faut-il avant de constater qu’au nord un minuscule 20 millions de Canadiens prétendent posséder le plus grand potentiel de ressources en Occident?
En tant que membre du Club de Rome, Trudeau avait martelé cette thèse de l’épuisement des ressources. Il rêvait du jour où les Européens, mais surtout les Américains, sortiraient de leur sommeil repu pour admettre la terrible réalité. Il voulait qu’ils modèrent leurs appétits. Mais les voilà éveillés. Et voilà qu’on leur offre, des rives du Saint-Laurent, la clé de tout un garde-manger.
Pierre Trudeau est de ces hommes d’État qui savent qu’il n’y a d’alliances que tactiques. Le premier président qu’il a fréquenté, Richard Nixon, s’était bien prêté à quelques gentillesses comme son discours d’Ottawa. Mais il n’a pas hésité à assener un coup de massue à l’économie canadienne en taxant toutes ses importations. L’intérêt national américain le réclamait. Son successeur, Gerald Ford, était plus avenant, ayant par exemple obligé les Français — toujours emmerdeurs neuf ans après la visite de de Gaulle — à admettre le Canada au nouveau club sélect des sept pays les plus industrialisés. Un cadeau qu’il se fait un peu à lui- même, car c’est aussi dans l’intérêt national américain que d’avoir le Canada comme «partenaire junior».
Trudeau aurait-il changé d’avis depuis qu’il écrivait 13 ans plus tôt: «Mais pourquoi pensez-vous donc que les États-Unis en useraient différemment avec le Canada qu’avec le Guatemala, quand la raison d’État l’exige et que les circonstances s’y prêtent?» La comparaison guatémaltèque est un peu forte. En 1954, les Américains avaient financé, armé et épaulé de leur aviation un coup d’État contre un réformiste élu avec 65% des suffrages mais qui avait eu le mauvais goût de confisquer, sans compensation, les avoirs de la puissante compagnie américaine United Fruit.
Au Canada, la situation n’exige pas de mesures aussi grossières. Une toute petite poussée suffirait à donner à René Lévesque un élan décisif et à enclencher le processus de désintégration du pays. «C’aurait été si facile», commente un proche de Trudeau, Allan Gotlieb, alors sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures. «Nul besoin pour le Président de se prononcer publiquement. Il aurait suffi qu’un diplomate quelconque lâche quelques mots d’encouragement.» Chacun aurait compris le signal. «La capacité des Américains de semer le trouble [mischief, dit-il en anglais] était gigantesque, gigantesque», dit-il encore.
Que les séparatistes puissent faire le tour des patelins du Québec et déclarer que, quoi qu’il arrive, Washington voit d’un bon œil la construction du nouvel État, et le discours fédéraliste prendra eau de toutes parts. Le proaméricanisme de l’électorat conservateur québécois n’est un secret pour personne. L’idée de quitter le Canada lui donne des frissons. Le quitter avec l’aval des États-Unis le rassurerait.
Les conditions énoncées par Trudeau — «quand la raison d’État l’exige et que les circonstances s’y prêtent» — semblent réunies. «Si une grande puissance mondiale [la France] avait désiré la destruction du Canada, pensait en tirer profit et y contribuait, pourquoi pas une deuxième?» demande Gotlieb. À Ottawa, d’autres mandarins de la politique étrangère jonglent avec ce scénario. «L’idée nous traversait l’esprit», confirme l’ex-ambassadeur canadien aux États-Unis, Charles Ritchie. «On se demandait si les Américains ne se disaient pas: “il serait plus facile de composer avec ce voisin du nord s’il était divisé en morceaux, et nous pourrions conclure un marché avec le Québec”.»
Des preuves? Il n’y en a pas. Aucune. Nulle part. «Mais on ne pouvait croire qu’il n’y avait pas dans les entrailles de l’administration américaine des gens qui proposaient cette idée», dit Gotlieb.
La tentation semble d’autant plus forte qu’à mi-parcours de cette décennie, les relations canado-américaines laissent au Sud un fort goût d’amertume. En 1975, le ministre Mitchell Sharp annonce la mort définitive de la «relation spéciale» entre le Canada et les États-Unis. Avec son patron le premier ministre, il veut en quelque sorte «séparer» le Canada de l’Amérique du Nord, le mener dans cette «troisième voie» de relations avec l’Europe et le Japon. Un virage stratégique mal accueilli aux États-Unis, où l’hebdomadaire financier new-yorkais Barron’s fustige «l’anti-américanisme» qui s’empare du Canada. Trudeau choisit ensuite 1976 pour crier «Vive Castro!» à La Havane, ce qui n’aide pas sa popularité au pays de l’anticastrisme militant.

La même année, William Porter, le prédécesseur d’Enders comme ambassadeur américain à Ottawa, célèbre son départ en portant un toast empoisonné devant une petite troupe de journalistes invités à un cocktail d’adieu. Quittant le terrain des mondanités, Porter se met à réciter en termes peu diplomatiques une liste des méchancetés dont son pays accuse les Canadiens: la politique de l’énergie, d’abord et surtout; le tamisage alors modeste mais tout de même dérangeant des investissements étrangers (lire «américains»); une législation qui empêche les stations de télévision américaines de profiter pleinement des publicités d’entreprises canadiennes. La liste de Porter a été préalablement revue et approuvée par le Département d’État et la Maison-Blanche.
Porter est d’autant plus cinglant que, contrairement à l’usage, Trudeau et ses ministres ont refusé de le saluer avant son départ. Ils espèrent un remplaçant plus avenant. Ils héritent d’Enders qui, à sa première sortie publique en mars, affirme sans ambages: «de mon côté de la frontière, les gens ont l’impression que leurs intérêts ne sont pas pris en considération» quand les Canadiens arrêtent leurs décisions. En juin, il précise sa pensée. «Nous tentons de faire passer ce message: le Canada ne peut réduire unilatéralement ses relations avec les États-Unis et s’attendre à ce que nous ne réagissions pas.» En septembre, finalement, Enders dénonce le «style paranoïaque» avec lequel les Canadiens mènent leur politique américaine.
Enders et Trudeau personnifient alors la mésentente canado-américaine.
«René Lévesque», soupire un haut fonctionnaire fédéral, «avait beaucoup de cartes dans son jeu» américain. Son équipe en est consciente quelques mois avant l’élection, constate Daniel Latouche, un observateur sympathisant qui deviendra conseiller de Lévesque. Il écrit que les péquistes «espèrent tirer le maximum du climat tendu qui prévaut aujourd’hui dans les relations canado-américaines».
L’appréhension fédérale serait moindre si la «destinée manifeste» n’était qu’un marotte de Yankees. Mais d’une mer à l’autre, des provinces canadiennes autres que le Québec se laissent bercer par l’idée d’appartenir à la grande famille américaine. Même les plus loyaux sujets de Sa Majesté.
Un diplomate américain à Ottawa, en tournée dans les Maritimes en 1964, n’en a pas cru ses oreilles lorsque le lieutenant-gouverneur d’une de ces provinces lui a fait cette remarque au sujet du Québec: «Laissons ces bâtards partir, de toute façon vous nous prendrez bien comme 5Ie État!» En 1976 est né un parti politique prônant l’indépendance de l’Ouest canadien, et certains de ses membres iront frapper à la porte de l’ambassadeur américain pour lui demander quelque appui. (Il refusera.) Déjà, le premier ministre de l’Alberta, Peter Lougheed, est accusé d’aller chercher à Washington des alliés contre la politique énergétique d’Ottawa. Au Nouveau-Brunswick, un groupe d’hommes d’affaires anonymes demande à une firme de consultants d’étudier la faisabilité d’une annexion de leur province aux États-Unis, en cas de sécession du Québec.
Pierre Trudeau voit donc d’un coup son échiquier politique basculer. Ayant diagnostiqué le décès de la menace séparatiste, il pensait que rien ne le retenait d’opérer, comme il s’y emploie depuis deux ans, son divorce d’avec le géant américain. L’élection du 15 novembre lui fait comprendre combien il a besoin de son voisin.
Ce n’est pas nouveau, Trudeau porte peu d’intérêt à tout ce qui est américain. Sur ce plan comme sur cent autres, il représente le contraire de René Lévesque. Un de ses plus brillants observateurs à Ottawa, Richard Gwynn, résume ainsi la relation de Trudeau à la chose américaine: «De tous les premiers ministres canadiens depuis Mackenzie King, Trudeau comprenait le moins les Américains et faisait le moins d’efforts pour les comprendre. En dehors des voyages officiels, il connaissait à peine le pays, sauf les pistes de ski et les discothèques de Manhattan. Lui-même, comme Joe Clark l’a pertinemment observé, était moins un Nord-Américain qu’un Européen qui aurait grandi au Canada. Dit plus simplement, Trudeau était un snob au sujet des Américains.»
Il n’en a plus les moyens.
Enders à la manoeuvre
Après ses entretiens avec Trudeau, Desmarais et Sinclair, Enders part pour Washington. Il voit Henry Kissinger, le secrétaire d’État sortant, Brent Scowcroft, le conseiller du Président à la sécurité nationale, sortant aussi. Il rencontre également les membres de l’équipe de transition de Jimmy Carter, qui se prépare à entrer en fonction dans moins de deux mois. Personne, dans cette tournée de consultations, ne voit d’intérêt américain à la désagrégation du Canada.
Enders propose à chacun de mettre en œuvre une politique à deux vitesses. D’abord, publiquement, le calme plat. Rien «d’agressif, de voyant et de trop public», explique-t-il. Tout en demi-teintes. Dire que c’est un problème canadien que les Canadiens vont résoudre. Mais attention, «il ne faut en aucun cas laisser l’impression que si deux Canada émergent [de la crise] plutôt qu’un, nous dirions “pas de problème, nous allons nous en accommoder”.» C’est en fait exactement ce qu’ils diraient, mais dans l’immédiat il faut faire savoir que les États-Unis «ne sont pas indifférents». Qu’ils ont, comme le plaide Pierre Trudeau, un intérêt dans la permanence de l’unité canadienne.
Telle doit être la position publique. En privé, on passe la deuxième vitesse. Pas de brusque accélération. Mais une présence plus nette. Enders et quelques autres, craignant une offensive tous azimuts du gouvernement québécois sur le territoire américain, veulent ériger des barricades idéologiques.
Ils appellent les grands journaux. Ceux de Washington, de New York, de Chicago, de Boston. Les «faiseurs d’opinion», explique Enders. Ils leur font part de la position fraîchement élaborée: «Le gouvernement américain ne tient pas à ce que l’idée d’un nouvel État au nord de la frontière reçoive un accueil impartial, et tel n’est pas le résultat que devrait produire une visite de M. Lévesque», raconte Tom Enders. «Nous étions très actifs à cet égard.»
Enders trouve au New York Times un allié précieux, influent et crédible pour cette préparation du terrain politique. Le chroniqueur politique James «Scotty» Reston, une des grandes plumes du journalisme américain, partage la volonté d’Enders d’épandre un peu d’huile sur la route américaine que doit emprunter René Lévesque.
James Reston est un ami de Lester Pearson, qu’il a connu au début des années cinquante, quand le futur premier ministre était ambassadeur à Washington, et qu’il a consolé ensuite lorsque Lyndon B. Johnson lui faisait des misères. Un des rares Américains intéressés à la chose canadienne, James Reston devient, après l’élection du PQ, un des meilleurs alliés des fédéralistes canadiens dans la presse américaine.
Rien n’est cependant plus pressé que de vacciner la future audience new-yorkaise de René Lévesque. Fin 1976, début 1977, on commence à parler de sa prochaine venue à une importante tribune de Manhattan, l’Economic Club. On voit ce discours comme la pièce maîtresse, ou le coup d’envoi, de l’opération de charme séparatiste aux USA.
Enders, Reston et quelques autres «passent un temps considérable au téléphone», se souvient l’ambassadeur, pour contacter les «membres importants de son auditoire, compagnies d’assurances, banquiers» et leur faire partager la position gouvernementale américaine.
Enders le fait d’autant plus volontiers que l’équipe de Carter, avant même l’intronisation du nouveau président, fait savoir qu’elle «approuve l’approche» qu’il a définie.
Entre plusieurs de ses va-et-vient à Washington au cours de l’automne et de l’hiver, l’ambassadeur Enders retourne voir le premier ministre pour lui livrer l’heureux résultat des courses: «Nous avons essentiellement attaqué le problème comme vous pensiez que nous devions le faire.»
Les deux hommes discutent alors longuement de l’ampleur que devrait prendre l’intervention américaine dans le débat (bi?)national canadien. Enders veut savoir si Trudeau «désire que nous soyons plus actifs», mais ils sentent tous deux un danger. «Nous sommes convenus qu’il serait dommageable que les États-Unis soient perçus comme les garants, dans un sens, de l’union canadienne», raconte-t-il. Subtilement, promet Enders, son gouvernement va s’assurer qu’entre Québec et les États, «aucun canal de communication séparé, aucune entente commerciale ou d’investissement séparée ne sera ouverte». Et si les péquistes veulent frapper à notre porte à Washington, nous la leur claquerons au nez. Il ne faut surtout pas donner au PQ l’argument de l’ami américain.
En revanche, il ne faut pas non plus que les firmes américaines aggravent le défaitisme ambiant dans la communauté des affaires anglophone de Montréal, en prenant, comme plusieurs Canadiens anglais, la poudre d’escampette. La tentation du sauve-qui-peut a beau être moins forte chez les Américains que chez les Montrealers, Enders ne se dépense pas moins «en un assez grand nombre de discussions avec des compagnies américaines» pour leur enjoindre de maintenir leurs activités québécoises. Ce qu’elles font pour la plupart. Enders leur conseille en plus d’être de bons citoyens, et d’appliquer à la lettre la nouvelle législation linguistique québécoise, la loi 101. Il le dira, dans son impeccable français, lors d’un discours à la Chambre de commerce de Montréal en mars.
La politique québécoise des États-Unis, c’est la proverbiale main de fer dans un gant de velours.
En cas de besoin, précise Enders, Washington aurait pu retirer son gant, montrer sa poigne de métal. «Si cela s’était avéré nécessaire, peut- être serions-nous allés à cet extrême» de la position publique, bruyante. «Certainement à ces premiers stades, si le Canada nous l’avait demandé, je n’ai aucun doute que nous l’aurions fait.» Mais, ajoute-t-il, «ce n’était pas si sérieux». Et le premier ministre canadien ne l’a pas jugé bon.
Bref, Trudeau et Enders s’entendent désormais à merveille.
Les deux hommes font pourtant une drôle de paire. «On ne peut pas dire qu’ils s’aimaient particulièrement», commente l’ancien bras droit d’Enders, Robert Duemling.
Un ambassadeur de Hollande, auquel on demande quelques mois après son arrivée au Canada de donner ses premières impressions sur le pays, capture l’élément qui à la fois unit et repousse les deux hommes: «Les deux individus les plus arrogants au Canada sont Pierre Trudeau et Tom Enders.»
Ils inaugurent cependant à l’automne 1977 une entente cordiale. Lorsque des déclarations publiques controversées d’Enders sont critiquées par le pauvre ministre Eugene Whelan, désorienté comme bien d’autres par ce renversement d’alliances, Pierre Trudeau prend la défense de l’ambassadeur, affirmant qu’il «respecte» ce «gentleman» qui «fait son devoir» en exprimant sans détour sa pensée.
Paul Desmarais et Ian Sinclair, hier chargés de rallier Enders à la cause, deviennent les instruments du nouveau couple politique. Ils ont servi, explique Enders, «de canal par lequel des messages que je voulais faire parvenir à Trudeau directement et personnellement pouvaient être acheminés. C’était utile à un moment où je ne voulais pas — et je suis certain que M. Trudeau ne voulait pas non plus — donner l’impression d’être toujours fourré chez lui». Desmarais et Sinclair, les coursiers les plus riches du monde. Ils ont dispensé Enders et Trudeau de se voir en tête-à-tête plus souvent que… «environ une fois par mois», selon l’estimation d’Enders. Ces deux-là avaient beaucoup de choses à se dire.
Lorsque le premier ministre libéral sera chassé du pouvoir en 1979 par le conservateur Joe Clark et sera tenu pour un paria politique, Enders l’invitera à la splendide soirée qu’il offre pour le mariage de sa fille. Célibataire depuis sa séparation, Trudeau fait son apparition après tous les invités, choisit la plus jolie des femmes présentes, la fait virevolter sur le plancher de danse jusqu’à lui faire oublier l’existence de son cavalier, et l’entraîne avec lui vers la sortie.
Mais n’anticipons pas. À la fin de 1976, sur le front américain de la guérilla politique qui s’ouvre entre Ottawa et Québec, Pierre Trudeau a gagné une importante bataille. Il n’a pas, il le sait, gagné la guerre. Enders est un allié solide, certes. Mais qu’en est-il du puissant Congrès américain, où logent certains des plus durs critiques de l’effronté Canadien? Et Enders, apparenté au camp républicain par ses états de service, peut-il vraiment parler au nom de la nouvelle administration démocrate, dont les membres — notamment cette «mafia géorgienne» que le Président recrute dans son État d’origine — forment une masse d’inconnus?
Trudeau ne veut surtout pas se faire resservir à la sauce canadienne la citation la plus célèbre de la culture de Géorgie: «Frankly, my dear, I don’ t give a damn.» Tant que le nouveau président n’aura pas énoncé, du haut du pupitre présidentiel, sa préférence pour un Canada uni, Trudeau ne sera qu’à moitié rassuré. Il prend rendez-vous avec Carter pour le 21 février suivant.
Et il ne se hasarde plus à mettre en rogne son nouvel allié. Trudeau, l’ancien trouble-fête, l’ancien snob dédaigneux des Américains, devient pour les États-Unis le plus charmant des voisins. Il ne faut donner à Washington aucune raison, pendant les années troubles qui s’ouvrent, de souhaiter la disparition du Canada. Bientôt l’agence de tamisage des investissements se fait si gentille avec les compagnies américaines que Barron’s, hier alarmé par l’anti-américanisme au nord, peut écrire: «La seule compagnie étrangère qui ne pourrait s’installer au Canada est Murder Inc.» Les pubs canadiennes réapparaissent sur les télés américaines. La «troisième option» retourne au néant. Les rapports avec Washington sont de nouveau «les plus importantes de toutes nos relations extérieures», annonce Trudeau. Il y avait longtemps!
La politique énergétique canadienne se fait tout à coup plus conciliante. Début 1977, pendant qu’une vague de froid traverse le continent, Trudeau ouvre les vannes de son pétrole vers une Amérique reconnaissante. Et ce fameux pipeline qui doit traverser le Canada verra finalement le jour, le vent politique ayant tourné.
Sentant l’ouverture, le fin politique Enders en profite pour entonner la vieille rengaine du libre-échange, de la «convergence» des économies d’Amérique du Nord.
Trudeau a raison de ne rien tenir pour acquis. Car entre temps, la «ligne» présentée par Enders n’est pas reprise par toute la diplomatie américaine. Fin janvier, lorsque le chef du pupitre Canada au Département d’État, John Rouse, est envoyé à Chicago pour annoncer à un groupe d’hommes d’affaires comment s’articule la position américaine à ce sujet, on ne perçoit guère que le gant de velours.
«Le gouvernement américain n’a rien à dire au sujet du Québec et de son avenir au sein du Canada, sauf que ce problème est uniquement et entièrement canadien. C’est un problème qui doit être résolu par les Canadiens sur la base des intérêts du Canada, sans la moindre intervention américaine, bien intentionnée, accidentelle ou autre», explique-t-il.
Sa visite à Chicago a surtout pour but de contrer les propos disséminés par un des membres les plus proaméricains du nouveau cabinet péquiste, Rodrigue Tremblay. Ministre de l’industrie et du Commerce, auteur en 1969 d’un livre prônant la constitution d’un marché commun Québec-États-Unis, Tremblay affirme à qui veut l’entendre et vient répéter aux hommes d’affaires rassemblés à Chicago que son gouvernement «a de bons contacts au sein du gouvernement américain», que des responsables américains appuient l’autonomie du Québec et jugent artificielle l’économie canadienne construite sur l’axe Est-Ouest, alors que les rapports Nord-Sud, qu’aiderait à promouvoir l’indépendance du Québec, seraient plus «naturels».
Le Parti québécois «voulait créer l’impression qu’il avait un appui quelconque des États-Unis. C’était exactement ce que nous voulions éviter», raconte un cadre du département d’État, Richard Vine. Il a donc envoyé Rouse «avec la mission explicite de s’assurer que cette impression soit dissipée».
À Chicago, Rouse rétorque donc à Tremblay que son gouvernement voit au contraire à sa frontière nord un Canada «vigoureux, confiant en lui-même, indépendant et engagé activement dans le monde». Pour ce qui est des contacts québécois à Washington, il énonce la politique officielle: «Ottawa représente les intérêts du Québec à Washington», un principe que «le gouvernement américain va continuer à respecter». Pour les contacts, donc, vous repasserez !
Le directeur du pupitre canadien envoie cependant quelques fleurs au nouveau gouvernement québécois en affirmant que le problème québécois «est dans les mains de leaders responsables dans les deux camps».

Pour lire la suite: Dans l’oeil de l’aigle
(épuisé en librairie, disponible ici et en format PDF).