Les démolinguistes de l’OQLF ont fait tourner leurs logiciels prévisionnels pour tester la mesure la plus ambitieuse avancée depuis la loi 101 pour redresser le français : une immigration à 100 % francophone. Leur conclusion est brutale. La tendance à la baisse de la population qui a le français comme langue première est si forte, si lourde, si implacable, que même l’ajout de 100 % d’immigrants économiques parlant français pendant 25 ans ne suffirait pas à l’endiguer. C’est énorme. Comme se faire dire que le réchauffement climatique est inéluctable. La démonstration est donc faite que ce remède a un effet mesurable pour réduire la température du patient. Mais il ne suffit pas à éliminer la fièvre. Devant cette information nouvelle, le pharmacien compétent comprendra qu’il doit retenir ce remède comme base du traitement, mais lui ajouter d’autres ingrédients.
(Ce texte a d’abord été publié dans Le Devoir.)
Il lui faut poser le bon diagnostic pour concevoir la multithérapie gagnante. Le patient n’est ni mort ni mourant. Son système immunitaire est atteint. En clair, la proportion des Québécois qui font partie des ni-ni augmente. Ni francos ni anglos, ils parlent une langue tierce à la maison. Le processus organique qui fait qu’un jour ils tomberont, à la table de leur petit-déjeuner, d’un côté ou de l’autre de l’alternative linguistique est la clé de notre avenir. Il faudrait que ce transfert se fasse à 90 % vers le français pour maintenir la prédominance francophone actuelle. Il plafonne à 55 %. Rien ne peut dicter ce choix. C’est la réalité linguistique collective qui l’annonce, le prépare, le conditionne. La politique linguistique, elle, peut pointer, ou non, dans la bonne direction.
Dans le peloton de tête des déterminants de ces transferts on trouve : la langue parlée au travail. La dégradation de la situation va comme suit à Montréal : les milieux passent de la situation actuelle, bilinguisme où le français est prédominant (1), à un bilinguisme intégral (2), puis à un bilinguisme à prédominance anglophone (3).
On avait compris des derniers recensements que la proportion des salariés montréalais passée à l’étape 2 (bilinguisme intégral) était de 9 % en 2006, puis de 15 % en 2016. La seconde étude publiée cette semaine, réalisée par Statistique Canada à la demande de l’OQLF, indique qu’en 2018, on en était à 25 %. Un bond fulgurant de 10 points de pourcentage en deux ans.
C’est capital. Le recul de la prédominance du français, la généralisation du bilinguisme intégral, la dévalorisation du français langue de travail commune ouvrent une voie royale à l’augmentation des transferts vers l’anglais.
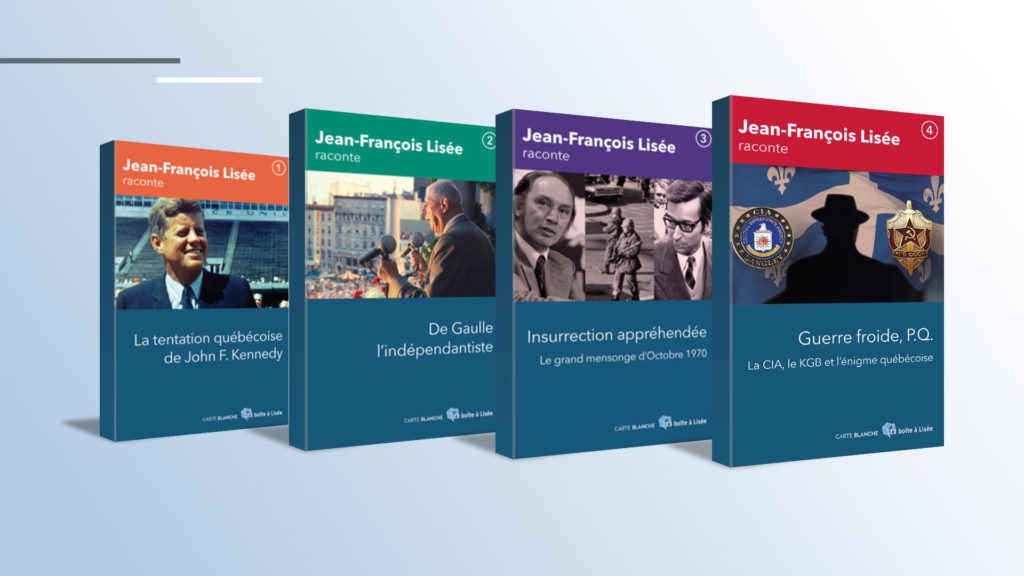

Voilà pour le danger. L’intérêt de l’étude est de raffiner le diagnostic en départageant le bilinguisme incompressible — le fait de parler anglais aux clients ou fournisseurs hors Québec — et le bilinguisme facultatif — celui qui atteste que le français n’est pas, chez nous, la langue commune. Ainsi, les salariés montréalais admettent que la moitié de leur utilisation totale de l’anglais est consacrée à servir… la clientèle du Québec. Donc des citoyens non francophones du Québec, dont on nous répète pourtant à satiété qu’ils parlent couramment le français. Cette clientèle non francophone fait quotidiennement le choix de ne pas faire du français sa langue d’interaction avec les salariés, pourtant majoritairement francophones. On dira : le client a toujours raison.
Alors, voyez ceci : dans plus du tiers des cas, l’anglais est utilisé parce que « les personnes avec qui je travaille préfèrent utiliser cette langue ». Preuve que les collègues non francophones, minoritaires, imposent l’anglais aux francophones, majoritaires. Pour une combinaison de raisons : leur maîtrise du français n’est pas suffisante et/ou le respect général de la notion de français langue commune s’affaiblit.
Un geste aussi lourd que celui de la loi 101
La mondialisation est un facteur réel, justifiant au moins 41 % de l’utilisation de l’anglais (le total est de plus de 100 %, car les raisons sont multiples). Si c’était le seul facteur, nous serions cuits, car nous ne faisons pas le poids face à la mondialisation. Heureusement, le principal facteur nous appartient : au Québec même, dans l’entreprise et parmi la clientèle, le français n’est pas la langue commune. Voilà ce qu’il faut changer. Comment ?
Puisque l’immigration francophone de tous est une condition nécessaire mais non suffisante, il faut poser un geste aussi lourd que celui de la loi 101. La décision, à l’époque, d’obliger tous les francophones et tous les futurs enfants d’immigrants à aller à l’école française et d’imposer le français dans tout l’affichage commercial était à la fois l’expression d’une volonté politique forte et l’imposition d’un changement concret dans la vie individuelle d’une large part de la population, principalement non francophone.
Un demi siècle plus tard, cette combinaison doit se retrouver dans une action forte qui aura pour résultat de (ré)installer le français langue commune dans l’entreprise montréalaise. Pour y arriver, les seuls contrôles a posteriori sont voués à l’échec. Il faut changer la compétence et l’état d’esprit linguistiques de chaque nouvelle cohorte de salariés, principalement non francophones.
Cela passe, vous me voyez venir, par la réelle exigence du français dans l’enseignement postsecondaire de tous : les cégeps en français pour tous (y compris les anglos et les allos), la connaissance du français préalable et des cours de français pour tous les étudiants étrangers, l’éducation professionnelle en français pour tous et, dans les universités anglophones, l’examen de français obligatoire et éliminatoire pour tous.
Cette action structurante non seulement assurera une réelle maîtrise du français pour tous les diplômés et futurs salariés montréalais, mais enverra aussi le signal politique que le français n’est, que cela plaise ou non, ni accessoire ni optionnel, mais incontournable.
Il faudrait, pour cela, que MM. Legault et Jolin-Barrette, comme MM. Lévesque et Laurin en leur temps, soient prêts à encaisser les effets secondaires politiques du traitement. C’est peut-être trop leur demander.
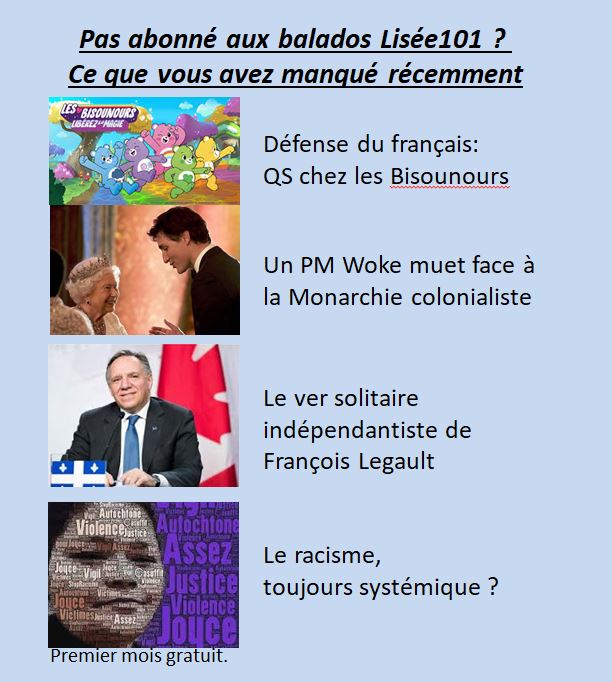


Vous avez raison sur tous les points. Depuis 1995 nous avons dormi profondément. Serons-nous capables de convaincre les 2 dernières générations de francophones, de faire ce sacrifice…ils sont tellement enracinés dans la culture anglo-américaine qu’ils sont gênés de parler la langue de leurs ancêtres.
Tout à fait d’accord