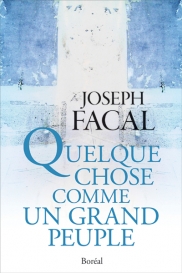 L’ancien ministre, professeur aux HEC, chroniqueur et lucide Joseph Facal offre avec son nouveau Quelque chose comme un grand peuple (Boréal), un livre à son image.
L’ancien ministre, professeur aux HEC, chroniqueur et lucide Joseph Facal offre avec son nouveau Quelque chose comme un grand peuple (Boréal), un livre à son image.
Éveillé, convaincu, systématique, pédagogique. Le lire, c’est l’entendre articuler chacun de ses arguments, à sa singulière manière. Il nous avertit d’entrée de jeu que le Québec d’aujourd’hui est divisé sur une nouvelle ligne de fracture :
Le nouveau clivage dominant au Québec, en plus de celui qui persiste autour de la question nationale, semble opposer ceux qui osent et ceux qui craignent.
Ceux qui osent, donc, proposer des réformes majeures et essentielles et ceux qui militent pour l’immobilisme. Facal précise que, pour lui, « oser signifiera tantôt essayer du nouveau et tantôt revenir à des valeurs éprouvées dont nous avons eu tort de nous éloigner ».
Après avoir donné sa lecture du passé, du présent, de l’éducation et du débat sur les accommodements raisonnables, où ses arguments portent, Facal mord dans les questions économiques et de politiques publiques qu’il affectionne depuis son passage au Conseil du Trésor. Au niveau de l’analyse, on trouve dans ces pages un Joseph Facal plus nuancé, moins cassant, que dans ses chroniques ou sorties précédentes.
Il met son intelligence et sa fougue au service de la direction à donner: effort, efficacité, productivité, épargne, responsabilité, prévoyance. Que du bon pain. Il se refuse cependant à dépasser ces généralités car, écrit-il, les réponses aux défis du Québec sont connues : « On ne compte plus les articles, les ouvrages et les rapports d’experts qui proposent des listes de réformes à accomplir. »
On reste ainsi sur notre faim car on croit Facal capable de synthèse, ce qu’il offre, et d’originalité, ce dont il nous prive. Ses chapitres sur la richesse et le progrès social se contentent de reprendre l’esprit, voire la lettre, de ce qu’on trouvait déjà dans le Manifeste pour un Québec lucide, dans le rapport Montmarquette-Facal-Lachapelle sur la tarification des services publics et dans plusieurs autres rapports remis aux autorités.
Ce qui le confine dans le sillon de la pensée dominante de centre-droit des élites économiques, sillon qu’il creuse avec ardeur. L’économie est ce qu’elle est, les défis sont ce qu’ils sont, ceux qui ne les voient pas sont aveugles et si on réunissait, selon lui, les 1000 personnes les plus intelligentes du Québec dans une même pièce, elles seraient pour l’essentiel d’accord sur les réformes à appliquer, celles des Lucides.
Facal n’est pas un néo-libéral — il prend soin de nous le rappeler et on le croit. Mais on comprend bien que son ouverture aux questions sociales ne viennent que teinter son approche économique classique. Elle n’en constitue nullement un des moteurs. L’économie sociale et solidaire, l’entrepreneuriat syndical, l’investissement social comme création de richesse, la nouvelle logique écologique, même, n’apparaissent pas sur son écran radar.
Pour les progressistes qui, comme moi, se rangent dans le camp de ceux qui veulent oser, et non dans celui de ceux qui craignent, Joseph Facal est un interlocuteur valable au centre-droit. Et Dieu sait qu’il en faut. Mais on ne peut attendre de lui une capacité de concilier les défis économiques québécois et une volonté d’innovation sociale, voire de sortir des sentiers battus.
Pour les indépendantistes qui, comme moi, se rangent dans le camp de ceux qui veulent oser l’affirmation du caractère national québécois, de la prédominance de sa langue, de ses repères identitaires, sans inhibition ni fermeture, Joseph Facal est un précieux compagnon.
