La meilleure façon de nuire à une bonne cause est de la pousser jusqu’à l’absurde.
Les nouvelles sont un peu moches pour les jeunes universitaires en histoire de la région de Québec. S’ils souhaitaient parfaire leur parcours, en maîtrise ou au doctorat, avec l’appui d’un enseignant de pointe et des budgets qu’offre une chaire du Canada, l’occasion leur a filé entre les mains à 16 heures le lundi 8 novembre dernier. À ce moment, aucun candidat acceptable n’avait postulé pour diriger à l’Université Laval des chaires d’histoire de l’Amérique latine, d’histoire romaine, d’histoire du Canada-Québec et d’histoire de l’art du Québec et du Canada. Comme chacun le sait désormais, les hommes blancs non handicapés ne pouvaient pas aspirer à occuper la direction de ces chaires, comme celle de biologie dont on parle depuis la semaine dernière. Il n’est pas interdit de penser que ces chaires auraient trouvé preneurs si seule la compétence, et non le genre ou la couleur de peau, avait été considérée. Au total, cette année, Laval a droit à trois de ces Chaires, tous champs d’études confondus. Toutes les facultés montent des projets et tentent de trouver des porteurs non-blancs pour atteindre la cible et figurer, en juin, parmi les trois finalistes. Beaucoup tombent au combat dès la première étape.
Pour comprendre comment l’Université Laval se trouve dans ce pétrin, il faut procéder à une vérification statistique simple. Pour avoir droit à la manne fédérale, les universités doivent atteindre des seuils stricts en matière de diversité. Pour les femmes et les handicapés, leur proportion est répartie équitablement dans le pays. Mais la cible que l’université doit atteindre en termes de « minorités racisées » est de 22%. C’est la moyenne canadienne. Quelle est la proportion de ces minorités à Québec ? Statistique Canada est précis : 6,5 %. (Et c’est précisément la proportion présente dans le corps professoral à Laval.) Et quelle est-elle à Toronto? 51,5 %
Bref, les universités torontoises peuvent combler leurs chaires du Canada en n’affichant que la moitié de la diversité présente sur leur territoire et n’ont qu’à se pencher pencher pour trouver, localement, des professeurs répondant au portrait-robot. Laval (ou Rimouski, Sherbrooke ou Chicoutimi) doivent recruter loin, très loin, et s’adonner à une grande séduction. Pour bien savourer la situation, supposons qu’un apôtre de l’accès à l’égalité ait déterminé qu’historiquement les Canadiens-français avaient souffert de discrimination en études supérieures. J’invente, je sais mais, on jase, là. Pour redresser ce tort, il sommerait toutes les universités du pays à embaucher leur juste part de profs C-F, soit 23 %, la moyenne canadienne, sous peine de perdre leur financement. On gages-tu que l’Université Laval n’aurait aucune peine à recruter, mais que la chose serait pénible à Toronto et à Edmonton ? Et que cette mesure aurait un temps de vie équivalent à celui d’un promeneur de trottinette sur la Métropolitaine ?
Voilà des subtilités qui ont échappé à ceux qui ont pris la décision de mettre nos universités dans cet entonnoir. Qui sont-ils ? Les membres de la Commission canadienne des droits de la personne. Répondant à des plaintes d’universitaires mécontents de la sous-représentation des minorités dans le programme des Chaires du Canada, la Commission a accepté d’emblée qu’il était juste et bon que les titulaires de ces chaires soient dans un délai assez court représentatifs de l’arc-en-ciel des différences qu’on retrouve, en moyenne, dans la société canadienne. La Cour fédérale a estampillé ces accords et leur a donné force de loi. J’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé de trace montrant que des démographes, des pédagogues, des spécialistes de la science universitaire de pointe aient été consultés avant que ces décisions ne soient prises. Et surtout pas des élus réunis en commission parlementaire. De plainte en plainte – car cela n’avançait pas assez vite au goût de certains, dont le célèbre plaignant Amir Attaran, de l’Université d’Ottawa — la Commission a conclu que les retardataires seraient privés de financement, point à la ligne.
On voit un peu partout une mobilisation forte pour accélérer la présence de membres des minorités en emploi, dans des postes de décision et de grande visibilité. J’applaudis. Il est indéfendable qu’on trouve encore trop peu de minorités visibles dans les corps policiers, chez Hydro et à la SAQ dans la région montréalaise, où la peau de 34% de nos concitoyens n’a pas la pigmentation qui dominait jadis en Normandie. Mais à Rimouski, où ils sont moins de 2% ?
La question est : jusqu’où doit-on aller, comment et à quelle vitesse ? Les pédagogues nous enseignent par exemple que la sous-représentation masculine au primaire et au préscolaire est un déterminant de la sous-performance des garçons, en manque de modèles. Utilisons la méthode des Chaires et retirons en dix ans le financement des garderies et des écoles primaires qui ne comptent pas 50% d’éducateurs et de professeurs mâles ! C’est raide, mais c’est pour la bonne cause. N’êtes-vous pas scandalisés par les taux d’échecs et de décrochage (31%) des garçons ?
Penchons-nous avec la même méthode déterminée sur l’industrie de la construction. La paie est excellente, l’emploi abondant, mais on n’y trouve pas 3% de femmes et cela ne progresse qu’à pas de tortue. Annonçons que, d’ici 2029, les seuls contracteurs pouvant postuler pour des travaux publics devront démontrer que la moitié de leurs travailleurs sont des travailleuses !
Si ces propositions vous semblent excessives, ou du moins précipitées, le cas des chaires est, à mon avis, pire encore. Car lorsqu’on réfléchit à la pyramide des compétences, n’est-il pas curieux que le lieu où on exige désormais une représentation stricte soit sur la pointe, là où il s’agit de faire franchir, par les meilleurs cerveaux, les frontières actuelles de la connaissance humaine ? Ne serait-ce pas là, où on doit trouver des remèdes au réchauffement planétaire et au cancer du sein, le lieu précis où le critère de recrutement devrait n’être que l’excellence ? Les chercheurs ont trouvé une façon pour éliminer les biais dans la distribution de subventions de recherche. Ils déposent leurs dossiers « à l’aveugle », c’est-à-dire sans inscrire leur nom ou celui de leur institution. Les candidats pour ces chaires ne devraient-ils pas être aussi choisis à l’aveugle ? Et tant mieux si l’excellence est incarnée par une autochtones handicapée ?
Constatant, dans les filières universitaires, une sous-représentation d’étudiants venant de certains milieux, n’est-ce pas là qu’il faut multiplier les passerelles pour les attirer ? Sachant que le Québec fait déjà mieux que le reste de l’Amérique pour tous les revenus modestes, avec les droits de scolarités les plus réduits et les prêts-bourses les plus généreux.
Nous sommes donc aux prises avec des apprentis-sorciers de l’égalité. Ils nuisent à la fois à la science, à l’éducation et à la cause qu’ils estiment servir.
(Une version plus courte de ce texte a été publié dans Le Devoir.)


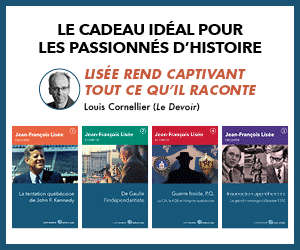
S’agirait-il simplement pour les candidats aux différents postes de cocher systématiquement la case « minorité visible »? Car qui établira le « seuil » de « visibilité » lors de l’analyse des candidatures ? Qui osera valider cette information et sur quelle base? Y aura-t-il des tests de coloration? Si les personnalités suivantes étaient candidates, seraient-elles rejetées: Gregory Charles, Céline Galipeault, Pascal Yacouvakis, Franco Nuovo, Dimitri Soudas, Amir Khadir, Pablo Rodriguez, Horacio Arruda, Joseph Facal, Christian Dubé, Sam Hammad, Michael Jackson…? Cette sélection pourrait être très arbitraire, et causer plus d’injustices qu’elle prétend en corriger.