Dans son premier roman, Tu aimeras ce que tu as tué, où le talent le dispute à la rage, Kevin Lambert désire ardemment la disparition de quelque chose. « J’ai rêvé ta fin toutes les nuits. Je ferai oeuvre de ta destruction », écrit-il. « Tu te retrouveras enfin dans la poubelle de l’Histoire, ne subsistant qu’au détour d’une phrase trop longue, mal rédigée, dans un paragraphe refoulé, peut-être coupé à l’édition, une bête note de bas de page, un renvoi à un autre ouvrage, épuisé, introuvable. »
L’objet de l’ire annihilationniste de Lambert est la ville de Chicoutimi. Remarquez, elle a changé de nom. Y a-t-il un lien avec l’ouvrage ? Faites vos recherches. La haine qu’il lui porte témoigne cependant de l’importance que la ville a à ses yeux et dans sa vie. Elle l’obsède. Si la pire attitude qu’on puisse adopter envers quelqu’un ou quelque chose est l’indifférence, l’acharnement est, au contraire, l’expression même du poids qu’on accorde à ce que l’on vilipende.
Ce qui nous amène au traitement réservé ces temps-ci au Parti québécois par ses trois rivaux de l’Assemblée nationale. Si les péquistes étaient faibles (disons, seulement trois députés), en fin de vie, porteurs d’un projet qui ne mobilise et n’intéresse presque personne, surtout pas la jeunesse, incapables de garder leurs anciens châteaux forts, on comprendrait qu’il n’y aurait aucun danger à permettre à ces grabataires politiques d’embaucher des attachés pour préparer les dossiers de députés qui parlent dans le vide. On laisserait à ces derniers poser chaque jour des questions que nul n’écoute et auxquelles on répond avec le sourire attendri de l’aidant naturel.
Étrangement, l’exact contraire se produit. La quantité d’énergie politique déployée par la CAQ, le PLQ et QS (que l’ex-chef du NPD Thomas Mulcair désigne « le cartel ») pour maximiser la marginalisation de ce qui reste de députation péquiste laisse pantois. En gros, en matière de budget de fonctionnement et de prise de parole à la période de questions, l’offre finale, agréée par les trois partis non péquistes, fait en sorte qu’un électeur libéral pèse 10 (cents ou questions), un électeur solidaire 4, un électeur péquiste 1, un électeur conservateur zéro.
Ce calcul suppose qu’on se préoccupe du principe démocratique, du nombre de votes exprimés, et pas seulement de règles archaïques qui font abstraction de l’existence des électeurs. Cela augurait bien, car un des participants de la négociation, Québec solidaire, avait fait du refus de ces archaïsmes un fer de lance depuis sa création. Le négociateur solidaire, Alexandre Leduc, nous détrompe sur ce point : « dans le partage du temps de parole, le partage des budgets, moi, dans toute la négociation que j’ai faite avec mes vis-à-vis, jamais je n’ai utilisé l’argument du pourcentage de vote ». C’était pourtant le seul et le plus puissant des arguments pour faire reculer l’injustice.

Pourquoi le chef péquiste a-t-il signé ? Parce que la CAQ lui a fait savoir que, sans signature, il obtiendrait moitié moins de sous et de droit de parole, ne serait personnellement considéré que comme un député indépendant sans droit de poser de questions au premier ministre, sans sécurité et sans voiture de fonction. Les autres membres du cartel vivaient fort bien avec ce chantage. En politique, on appelle ça exercer son rapport de force. Dans la vie courante, on parlerait d’extorsion de signature.
Le commentariat avait établi qu’à moins d’une question par jour pour le PQ, l’entente serait honteuse. De ce fait, la formation politique qui offrirait au PQ d’obtenir la question par semaine qui lui manquait était en position de récolter les applaudissements de la galerie pour sa magnanimité. Il est donc très significatif que ni le Parti libéral ni le parti dont le nom contient le mot « solidaire » n’aient voulu saisir l’occasion de s’attribuer ce mérite dans l’opinion.
On ne peut conclure qu’une chose. Le gain obtenu en mettant chacun — CAQ, PLQ, QS — le pied sur le tuyau à oxygène politique pouvant alimenter le PQ était pour eux supérieur à la perte de crédibilité que cette mesquinerie combinée allait générer. Il y a bien sûr le facteur temps. Les indignités commises pendant les premiers mois du mandat seront bientôt oubliées par l’électorat, dont la mémoire est remarquablement courte, et elles seront largement compensées, selon ce calcul, par la prise d’espace politique ravi au PQ pendant les quatre ans à venir.
Cependant, le cartel envoie aussi aux électeurs un signal fort : nous avons tellement peur du Parti québécois que nous sommes prêts à passer pour des brutes pour contenir son potentiel. C’est à dessein que cette chronique s’intitule « Les péquistophobes ». Les phobies, vous le savez, sont des peurs irraisonnées. Mais peut-être que les adversaires du PQ usent de raison, après tout.
Peut-être estiment-ils que le recul du français, l’arrogance fédérale envers le Québec, le chemin Roxham, Charles III, la mise en cause, demain par la Cour suprême, des lois sur la laïcité et sur la langue, l’éternel retour du Quebec bashing, bref que l’addition de ces facteurs ouvre au projet indépendantiste et à son seul porteur crédible, le Parti québécois, un potentiel de croissance qu’ils craignent par-dessus tout. Il est vrai qu’à l’été, le PQ était à 8 % dans les intentions de vote, en chute. Vrai qu’au dernier sondage Léger, il était à 18 %, en progression.
Une chose est sûre : pendant la campagne, par son attitude ferme, mais respectueuse envers ses adversaires, par son refus du serment au roi, Paul St-Pierre Plamondon a gagné dans l’opinion une réputation d’homme vrai, élégant et intègre. Le grand spectacle de la petitesse que les autres chefs de parti viennent de livrer en foulant aux pieds leurs promesses de collaboration et leur engagement envers la démocratie offre un contraste encore plus grand et met en lumière un PSPP à part, hors norme. Peut-être viennent-ils, à leur corps défendant, de lui rendre un grand service.
(Ce texte a d’abord été publié dans Le Devoir.)
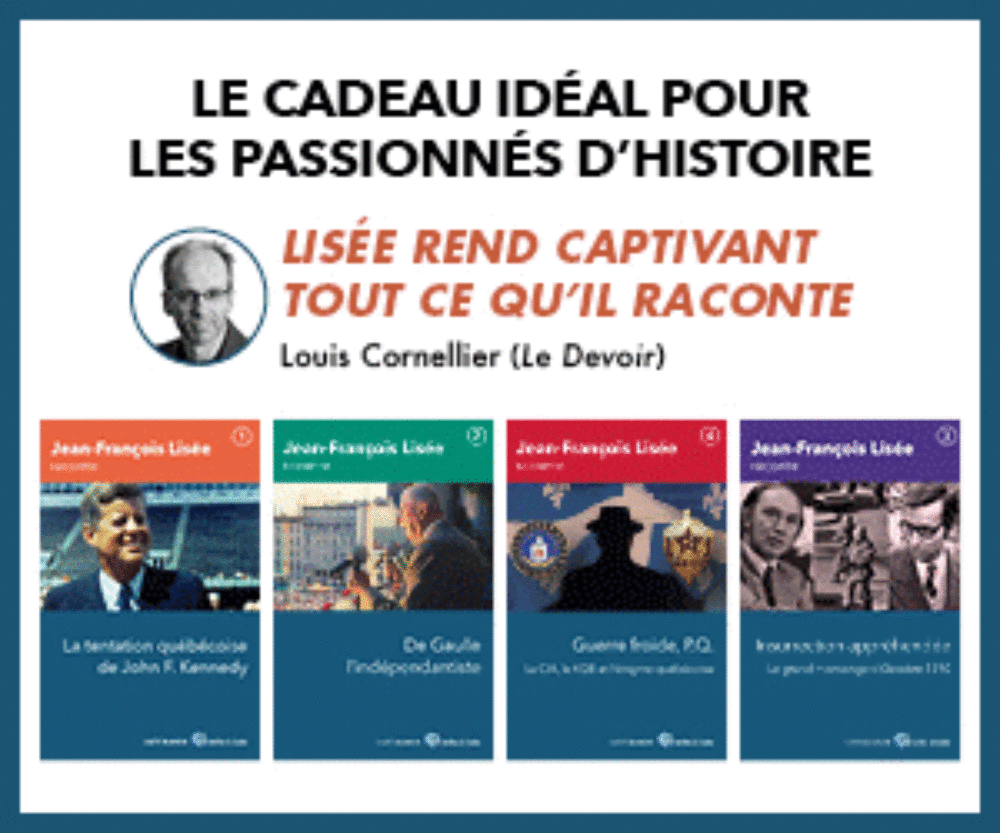


Oui, ce Plamondon est un grand homme. Il me fait penser à Charles de Gaulle qui aurait sûrement qualifié ses trois adversaires de « petits, mesquins, tracassiers. »