Pendant les vacances, quelques billets de blogue choisis, en rappel.
 La chose mérite d’être rappelée : les radios avaient d’abord refusé de programmer la chanson de Mes Aïeux, Dégénérations, lors de sa sortie en août 2004. C’est le public qui l’a imposé et en a fait, deux ans plus tard, le champion des palmarès.
La chose mérite d’être rappelée : les radios avaient d’abord refusé de programmer la chanson de Mes Aïeux, Dégénérations, lors de sa sortie en août 2004. C’est le public qui l’a imposé et en a fait, deux ans plus tard, le champion des palmarès.
L’historien Éric Bédard ouvre son excellent recueil Recours aux sources avec un essai sur Dégénérations : sa genèse, sa place dans la culture musicale, son message, les explications données par ses auteurs, son originalité dans le reste de la production de Mes Aïeux. Un travail de mise en contexte riche et signifiant. De la belle ouvrage.
Bédard s’en sert comme d’une pièce à conviction majeure dans son plaidoyer pour sortir la politique québécoise de son obsession pour l’avenir ou pour le présent et mieux l’enraciner dans une continuité historique où « l’avant » a encore un sens. Il écrit:
« Le succès du groupe répond moins à une nostalgie du bon vieux temps qu’à un désir de filiation qui prend forme dans un contexte où les Québécois francophones souhaitent renouer avec leur être identitaire. »
Pour Bédard, et on ne le lui conteste pas, Dégénérations fut la façon qu’ont eu ses auteurs et ses auditeurs d’affirmer, contre le vœu des radios cherchant à tout prix la nouveauté et en plein débat sur les accommodements raisonnables, que notre existence s’inscrit dans une durée, que nous sommes les héritiers (ou les fossoyeurs) de quelque chose, que nous ne sommes pas que des atomes dans un monde déstructuré.
C’était notre façon de nous dire, en un sens, conservateurs :
« Si l’on interprète le terme conservateur comme désignant un sain scepticisme par rapport à tout de qui est présenté comme un progrès irréversible – le marché autorégulé, la mondialisation, la fusion des cultures, la perfectibilité infinie de l’homme grâce à une rééducation planifiée – on pourrait peut-être qualifier Mes Aïeux de groupe conservateur. »
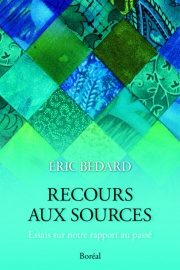 Éric Bédard, comme Mathieu Bock-Côté dans Fin de cycle dont j’ai parlé ici, sont des conservateurs, avec un « C » minuscule. (Ce qui ne les empêche pas d’avoir un préjugé favorable à ce que veulent, disent ou font les Conservateurs à majuscule, sauf sur la question nationale). Mais ils ont ceci de particulier qu’ils sont à la recherche d’une définition de leur conservatisme.
Éric Bédard, comme Mathieu Bock-Côté dans Fin de cycle dont j’ai parlé ici, sont des conservateurs, avec un « C » minuscule. (Ce qui ne les empêche pas d’avoir un préjugé favorable à ce que veulent, disent ou font les Conservateurs à majuscule, sauf sur la question nationale). Mais ils ont ceci de particulier qu’ils sont à la recherche d’une définition de leur conservatisme.
Ils sont conscients du degré de difficulté. Éric écrit : « En tentant de mieux comprendre le conservatisme, l’historien ne se comporte-t-il pas comme un ‘antiquaire’, attaché à des vieilleries inutiles, à une pensée passéiste? »
Tout dépend de la définition qu’on en donne, évidemment. Bédard et Bock-Côté sont très montés contre le récit dominant qui fait de la Révolution tranquille une rupture, plutôt qu’un tournant, de l’histoire québécoise. On les sent rageurs contre ce qu’ils appellent à répétition la « vulgate de la Grande noirceur », terme impropre, à leurs yeux, pour décrire un Québec cléricalo-duplessiste, certes, mais qu’ils voient plutôt gris pâle que noir foncé.
Je ne me permettrai pas d’entrer dans ce débat. Je noterai simplement qu’en 2012, le citoyen québécois qui était adulte du temps de Duplessis est maintenant âgé de plus de 70 ans, et que la question du conservatisme ne se joue plus sur le respect ou l’irrespect porté au Cheuf.
Mes amis Éric et Mathieu le savent, et tentent de donner des définitions plus actuelles d’une posture, pour ne pas parler de programme, conservateur qui serait plus à même de rassembler sous la tente souverainiste une partie de l’électorat qui s’y sent exclu par une élite péquisto-technocratique.
Au-delà des combats spécifiques évoqués dans le billet précédent (opposition au multiculturalisme, au cours Éthique et culture religieuse, à l’aseptisation des cours d’histoire, à la réforme pédagogique qui préfère le contenant au contenu), quelle définition donner à ce conservatisme québécois du XXIe siècle ?
Mathieu offre celle-ci :
« une disposition fondamentale défavorable à l’utopisme et à sa conséquence inévitable, la technocratisation de la société. Au conservateur, le mythe de l’homme nouveau fait peur, il l’inquiète ».
Et encore :
« La tradition, qui n’est pas qu’un bric-à-brac de coutumes plus ou moins désuètes, est le premier des contre-pouvoirs : elle limite la prétention démiurgique du pouvoir à refondre la société comme si elle lui appartenait, comme si la société appartenait à l’État. Elle rappelle que la société dispose de bien des savoirs accumulés par son expérience historique […] »
Éric ancre sa propre définition dans le principe même du combat souverainiste, en opposition à sa dérive multiculturaliste et chartiste. Il faut, écrit-il, comprendre :
« le conservatisme comme un respect du donné, comme un sain scepticisme face à toutes les vulgates progressistes. Si nous refusons, comme souverainistes, de nous poser en héritiers d’une histoire, nous risquons de dépouiller ce projet de l’un de ses principaux fondements. Ce qui donne vraiment sens à l’indépendance, cela reste le désir de reconnaissance d’une communauté historique, d’une culture précaire mais bien vivante. »
Souveraineté, conservatisme et « Projet de société »
Mes lecteurs me savent plutôt portés vers la gauche. J’ai même écrit un long essai sur les voies de sortie du capitalisme. Mais je suis très attentif aux écrits des Bock-Côté, Bédard, Joseph Facal et autres, qui habitent sur un autre versant du mouvement souverainiste.
Il arrive qu’ils me fassent sourire. Quand Mathieu écrit, par exemple, que le conservatisme représente peut-être « le seul avenir de l’idée d’indépendance », je crois entendre Amir Khadir tenter de me convaincre que seul un authentique projet de société de gauche peut mener à la souveraineté — et que le PQ est trop centriste pour y parvenir.
Ces questions sont importantes car elles posent la question de la coalition souverainiste à venir. Et, en-deçà, du positionnement politique d’un futur gouvernement péquiste.
Éric et Mathieu savent que je suis avec eux lorsqu’il est question de réintroduire le combat souverainiste dans une continuité historique, et identitaire, qui lui donne sa réalité, son épaisseur, sa logique, sa raison d’être.
La souveraineté ne pose qu’une question : la capacité pour une communauté historique d’acquérir la liberté de définir elle-même son avenir. Cette capacité n’est ni de gauche, ni de droite. Elle se vaut en elle-même.
Toute volonté de trop définir quel « projet de société » porterait un Québec souverain, toute volonté de figer même, comme le veut Québec solidaire, dans une constitution pré-référendaire les principes de gouvernement (écologiste, féministe, égalitariste, tout ce que j’applaudirais par ailleurs) constitue un déni de l’objectif même de la souveraineté : l’acquisition de la liberté. En lestant le projet du programme des uns et des autres – et nécessairement des uns à l’exclusion des autres – on confisque à l’avance la liberté qu’on prétend vouloir obtenir. Et en restreignant la coalition aux seuls citoyens qui partagent ces choix de société, on soustrait plutôt qu’additionner, on rend une victoire du Oui plus difficile encore.
Ce qui ne signifie pas que chaque composante du mouvement souverainiste ne puisse espérer voir ses thèses triompher dans le Québec indépendant de demain, et mobiliser leurs troupes et leurs électorats en fonction de ces espoirs. Plus il y aura de « projets » souverainistes, de droite comme de gauche, plus le rassemblement sera possible au point de passage commun: l’acquisition de la liberté politique. L’essentiel est de ne pas figer un projet comme le seul, à l’exclusion des autres.
Par ailleurs je retournerais contre ses auteurs le principe qui leur est cher du respect pour le « déjà là » — par opposition à toutes les innovations que les sociaux-démocrates tentent d’introduire. Cinquante ans de Révolution tranquille, cela fait beaucoup de déjà là, qui n’y était pas avant. De « maintenant là ». Et on ne peut, au nom de l’existence d’un électorat conservateur québécois qui ne s’est pas encore fixé, prétendre que le Québec n’a pas de centre de gravité politique, qu’on appelle rapidement des « valeurs québécoises », et qui sont très souvent en opposition avec les Conservateurs (avec la majuscule) qui sont au pouvoir à Ottawa.
Le sain scepticisme face au changement, c’est aussi le sain scepticisme face à la révolution conservatrice qu’on tente de nous imposer. Pour prendre un mauvais exemple, ce n’est pas parce que la reine est déjà là qu’on va applaudir son grand retour. D’autant que notre opposition à la monarchie était, elle aussi, déjà là.
Comme je l’écris dans La droite K.-O., j’estime que le Parti québécois, dont le centre de gravité est au centre-gauche, doit trouver le moyen de tendre la main aux électeurs conservateurs sans se renier et sans transiger avec ses objectifs de justice sociale. Une façon de le faire est de mettre en avant des thèmes qu’imposent l’actualité et qui transcendent les familles idéologiques : l’intégrité, le nationalisme économique, l’affirmation identitaire et la souveraineté.
Dans ce contexte, le mot « conservatisme » ne me semble pas d’une grande utilité. Stephen Harper lui fait beaucoup de tort. Gaullisme serait préférable, mais cela ne fait pas très québécois.
Éric Bédard, dans un de ses essais, donne la combinaison qui permet de réconcilier le projet indépendantiste avec les sources historiques de la nation. Il l’a trouvé chez René Lévesque :
« Héritier plus impatient qu’ingrat, Lévesque reprochait surtout aux élites d’autrefois d’avoir survalorisé le paysan au détriment du coureur des bois. Certes, comme les nationalistes traditionnels, il fallait s’inspirer de la ‘volonté de continuer’ des prédécesseurs, se souvenir que ce peuple était enraciné dans une histoire longue.
Mais le temps était venu pour ces racines de donner de meilleurs fruits. »
Voilà bien une attitude qu’il vaut la peine de retrouver, et de conserver.
Billet d’abord publié en avril 2012.
