À l’heure où on apprend que le futur « Top Gun » de l’Agence Santé Québec aura un salaire de bas — de base ! — de plus d’un demi-million, je me permets de reposer ma question habituelle: Ce serait combien, trop ?
Quand j’étais député de l’opposition, c’était une de mes questions favorites. Au premier ministre qui défendait la scandaleuse augmentation de rémunération des dirigeants qui avaient lancé Bombardier dans le mur. Au ministre des Finances qui justifiait les millions en primes accordées au président de la Caisse de dépôt. À celui de l’Énergie qui applaudissait le doublement de la rémunération du président d’Hydro. Ils étaient toujours d’accord avec ces hausses. Ils avançaient même qu’ailleurs, en Ontario, à New York, pour des postes équivalents, c’était davantage encore. Ah oui ? Alors, dites-moi, ce serait combien, pour vous, trop ?
Je n’ai jamais eu de réponse. Car dans la spirale ascendante des salaires gonflés à l’hélium, comme ils disent à Wall Street, « sky is the limit ! ». Ou comme le disait Alphonse Allais, « une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites ! ». Alors pourquoi ne fait-on que doubler, à 1,1 million, le salaire du président d’Investissement Québec ? Ne sommes-nous pas à risque de nous le faire piquer par la société de gestion d’actifs BlackRock, dont le président a fait 25 millions $ US l’an dernier ? Ou plus proche de nous par la Banque Nationale, dont le président a empoché 8,3 millions ? Et puis, si on double son salaire, cela signifie-t-il que, jusqu’ici, il ne donnait que son 50 % au travail ? Si on le quadruplait, n’obtiendrait-on pas un rendement de 200 % ? Pourquoi s’en priver, puisqu’on n’est pas à un million près ?
Il y a quand même des détails qui clochent. Pour retenir à la tête de la Caisse un homme de la compétence de Michael Sabia, on a craché jusqu’à 4 millions par an. Mais il a ensuite accepté un salaire 10 fois inférieur pour devenir pendant plusieurs années sous-ministre des Finances à Ottawa. Est-il trop tard pour demander un remboursement ? Puis, on l’a attiré à la tête d’Hydro Québec, mais en remultipliant son salaire. Pourquoi ?
Débattant récemment de ces questions avec un collègue conservateur, je l’ai entendu me demander « sur quelle planète » je vivais, moi qui mettais en cause la pertinence même de ces rémunérations. La meilleure question aurait été « dans quelle décennie » ? Car l’explosion des rémunérations des dirigeants d’entreprises, privées et publiques, est essentiellement une question de date, et non d’économie.
Jusqu’aux années 1980, les p.-d.g. du privé ne touchaient que 20 à 30 fois la rémunération du salarié moyen de leurs entreprises. L’ère Reagan-Thatcher a fait doubler cet écart pendant les années 1980, puis quintupler pendant les années 1990. On est désormais à 200 à 300 fois la rémunération du salarié moyen. Vous voyez, ce n’est jamais trop. Et cela n’a évidemment rien à voir avec l’économie, le talent, la croissance.
Une fois qu’on a retiré toutes les variables possibles de l’analyse, comme a tenté de le faire le Prix Nobel d’économie et chroniqueur Paul Krugman, on ne peut diagnostiquer qu’une cause à cette folie : un changement de culture en haut de l’échelle, la disparition de toute inhibition face à l’accumulation de richesse. La disparition de la notion de « trop ». Hier journaliste économique, l’actuelle ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, décrit brillamment dans son ouvrage Plutocrats comment ces super-riches se sont convaincus que toute atteinte à leurs rémunérations extravagantes serait un crime contre le sens commun. Sur quelle planète vivent-ils ? La leur, de toute évidence.
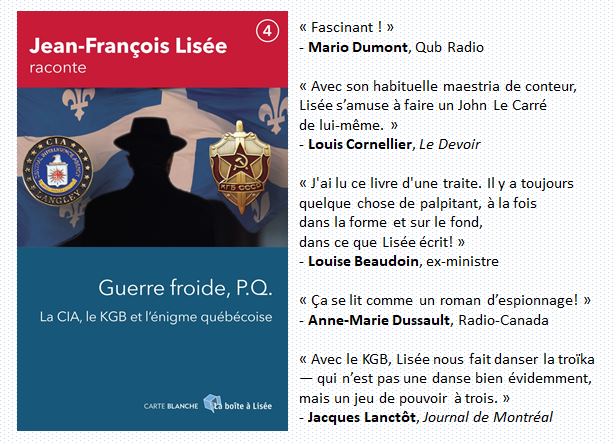
Une distinction s’impose ici entre, d’une part, la richesse accumulée par un entrepreneur qui crée un nouveau produit ou service et qui mérite les fruits de son labeur et, d’autre part, les cadres supérieurs qui n’ont rien inventé, mais sont des administrateurs interchangeables et surpayés, dont certains sont certes plus doués que d’autres.
Le salaire des grands employés de l’État présente un cas à part, quoi qu’en pensent MM. Legault et Fitzgibbon. D’abord, l’idée que leur rémunération doit s’apparenter à celle du privé est récente. Je propose depuis un certain temps qu’aucun salarié de l’État québécois ne puisse empocher davantage, primes incluses, que le premier ministre du Québec, soit environ 250 000 $ l’an, ce qui est cinq fois le salaire industriel médian.
Pourquoi suis-je certain que nous pourrions facilement pourvoir avec cette offre les directions d’Hydro, de la Caisse, d’IQ de très grands talents ? D’abord parce que ce fut le cas pendant des décennies. Ensuite parce que ces postes sont en soi extraordinairement attractifs. Dans une carrière québécoise, diriger la plus grande entreprise hydroélectrique en Amérique, ou un des plus grands fonds d’investissement au monde, ou coordonner la totalité de l’action économique gouvernementale, constitue soit le couronnement d’une carrière, soit une étape incomparable vers, ensuite, les fauteuils les plus rémunérateurs du privé.
J’aimerais pouvoir dire que l’appel du service public compte dans la balance, mais j’entends d’ici le ricanement des cyniques. Plus prosaïquement, des gens de talent sont disposés à réduire leurs attentes salariales pour détenir, pendant quelques années, le pouvoir de décision que confèrent ces postes. Ils ont ainsi l’occasion de laisser leur marque sur tout un secteur d’activité. Pourquoi pensez-vous que Michael Sabia est sous-ministre des Finances plutôt que banquier ces jours-ci ? Pour le pouvoir d’influencer l’économie de tout un pays.
Paradoxalement, à vouloir rendre immédiatement millionnaires les dirigeants de nos sociétés d’État, on sape le statut de leurs fonctions elles-mêmes. On laisse entendre qu’il n’y a pas de différence de nature entre diriger Hydro ou Walmart, entre gérer la Caisse ou KPMG. Ce faisant, on dévalorise certaines des fonctions les plus prestigieuses de la nation. On annonce que l’appât du gain doit déterminer le choix du dirigeant, plutôt que l’appel du défi, le goût du dépassement et, oui, la volonté de contribuer au service public et au bien commun.
(Une première version de ce texte a été publié dans Le Devoir.)
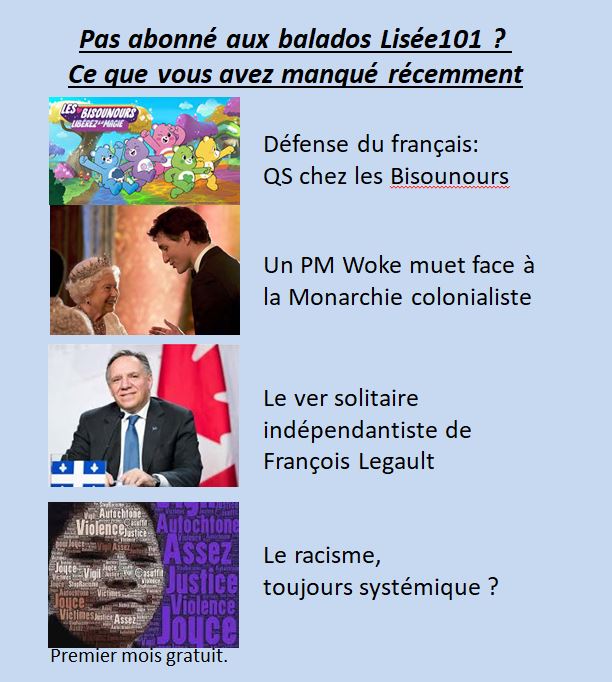


Culture du trop. Excellent article et sujet décourageant.