Il n’y a pas à proprement parler — enfin, que l’on sache — une internationale des despotes. On n’enseigne dans aucune université comment devenir dictateur et le rester. Les tyrans n’en sont pas moins très attentifs aux leçons de l’histoire. Tous ont été traumatisés par l’expérience soviétique. Mikhaïl Gorbatchev ne souhaitait qu’insuffler davantage d’initiative dans un modèle économique médiocre. Politiquement, il acceptait tout au plus de permettre aux citoyens de critiquer non seulement Staline, mais également, pourquoi pas, son prédécesseur Lénine.
Mais face au grand vent de la liberté, il est risqué d’entrouvrir une porte. Il s’en faut peu pour que le souffle devienne bourrasque, puis tempête. Bientôt, tout l’édifice est emporté. La flexibilité minimaliste de Gorbatchev a conduit à la chute du communisme, au démantèlement de l’empire, à sa propre destitution.
Le pouvoir chinois, en particulier, a saisi l’ampleur du risque et, au lendemain des manifestations de Tian’anmen, a jugé qu’il ne fallait jamais donner de l’espoir aux assoiffés de liberté. Mieux vaut, pour asseoir le pouvoir absolu, les laisser mourir de soif, au propre comme au figuré.
En Afghanistan, les talibans viennent de resserrer les boulons pour faire disparaître, entre autres, les derniers espaces de liberté disponibles aux femmes. Vous ne les trouverez plus en emploi ni dans les parcs, jardins, salles de sport ou bains publics. Aucune jeune fille ne peut dépasser désormais le cap de l’école primaire. Cette plongée dans l’obscurantisme coïncide avec la révolte des Iraniennes. Leur mouvement est contagieux. En Afghanistan même, des manifestations sporadiques de femmes solidaires ont été, évidemment, réprimées.
Il n’a pas échappé aux talibans que la révolution islamique iranienne avait pris un énorme risque en permettant aux femmes de vaquer à leurs occupations, pour peu qu’elles cachent correctement leurs cheveux. C’est ainsi que, malgré les mollahs, l’éducation secondaire et universitaire leur est restée ouverte, que des femmes sont devenues médecins, cadres d’entreprises, enseignantes, chercheuses. Libres dans leur tête, sinon au-dessus.

Les théocrates iraniens paient cette erreur historique depuis un mois. Comme l’explique dans Libération le sociologue franco-iranien Farhad Khosrokhavar, la révolte est passée par trois étapes, en cercles concentriques. La première fut celle des femmes, horrifiées par la mort d’une d’entre elles, emprisonnée pour avoir mal mis son hidjab. Elles furent soutenues par des hommes, beaucoup de jeunes. À cette phase portée par le cri « femmes, vie, liberté », a suivi une seconde autour du slogan « mort au dictateur ». La jeunesse, y compris adolescente, est descendue dans la rue, et la contestation a gagné les régions du Kurdistan et du Balouchistan. Là, les revendications autonomistes se conjuguent à la demande de liberté.
La troisième phase, en cours, est celle des grèves mobilisant des Iraniens plus âgés. Les fermetures des bazars, tenus par des microentrepreneurs, sont aussi emblématiques, ayant précédé historiquement les changements de régimes iraniens. La tradition musulmane d’accompagner un défunt au 40e jour du deuil produit aussi un effet de calendrier qui structure la colère dans le temps, le régime ayant pour l’instant fait plus de 416 morts, dont 51 mineurs, selon l’ONG Iran Human Rights. Sans compter les 15 000 personnes arrêtées — certaines spécifiquement accusées « d’inimitié envers Dieu » —, les confessions arrachées sous la torture et montrées à la télévision d’État.
Le dialogue est évidemment impossible. Toute réforme est écartée par des dirigeants qui croient avoir été choisis par Dieu pour appliquer son courroux. Le pouvoir ne connaît qu’une riposte possible : la répression. Elle a fonctionné contre les révoltes précédentes, nombreuses au cours du dernier quart de siècle. Jamais cependant une jonction si forte n’était advenue entre les femmes, des jeunes et des plus vieux, des régions.
Un régime dictatorial ne peut s’effondrer que par la force. Il y a deux cas de figure. Une partie de l’appareil militaire peut estimer le pouvoir incapable de maintenir l’ordre, et décider de le renverser (comme en Égypte), et en faire ensuite ce qu’il veut. Les ayatollahs iraniens ont cependant créé leur propre milice, les Gardiens de la révolution, qui, comme leur nom l’indique, ne gardent pas le pays ou le peuple, mais la révolution islamique. Ces gardiens sont présents au sein des forces policières et militaires régulières pour s’assurer de leur loyauté envers le régime.
Le second cas de figure est celui où une partie des policiers et soldats, et quelques gradés, font défection et se joignent au mouvement, devenant son bras armé. C’est ainsi que Lénine a réussi sa révolution. Dans ce scénario, il est possible que les Kurdes d’Irak, qui furent le fer de lance de la guerre contre le groupe État islamique, viennent à la rescousse des Kurdes d’Iran. (L’Iran a d’ailleurs fait une frappe dans le Kurdistan irakien récemment). Les femmes kurdes ont été particulièrement héroïques dans le combat contre Daech. Il y aurait une symbolique forte à les voir combattre les misogynes iraniens.
Si ce bras armé de la révolution gagne quelques batailles, le conflit va s’internationaliser. Des islamistes voudront venir au secours des mollahs, mais pas tous. L’Arabie saoudite serait heureuse de voir son ennemi iranien s’embourber dans un conflit interne. Les Syriens, et les Russes, pourraient choisir de soutenir l’allié iranien, qui a aussi tissé des liens avec la Chine ces dernières années.
Y aurait-il, aussi, des brigades internationales féminines venant au secours des soeurs iraniennes ? Comme le Dr Norman Bethune partant de Montréal avec la brigade Mackenzie-Papineau pour soutenir les républicains pendant la guerre civile espagnole ? La question est ouverte.
Mais à moins que le régime réussisse à broyer cette révolte dans le sang, nous serons devant un cas d’espèce. Une première vraie révolution portée par des femmes, pour leur liberté et leur égalité, cheveux au vent.
(Ce texte a d’abord été publié dans Le Devoir.)
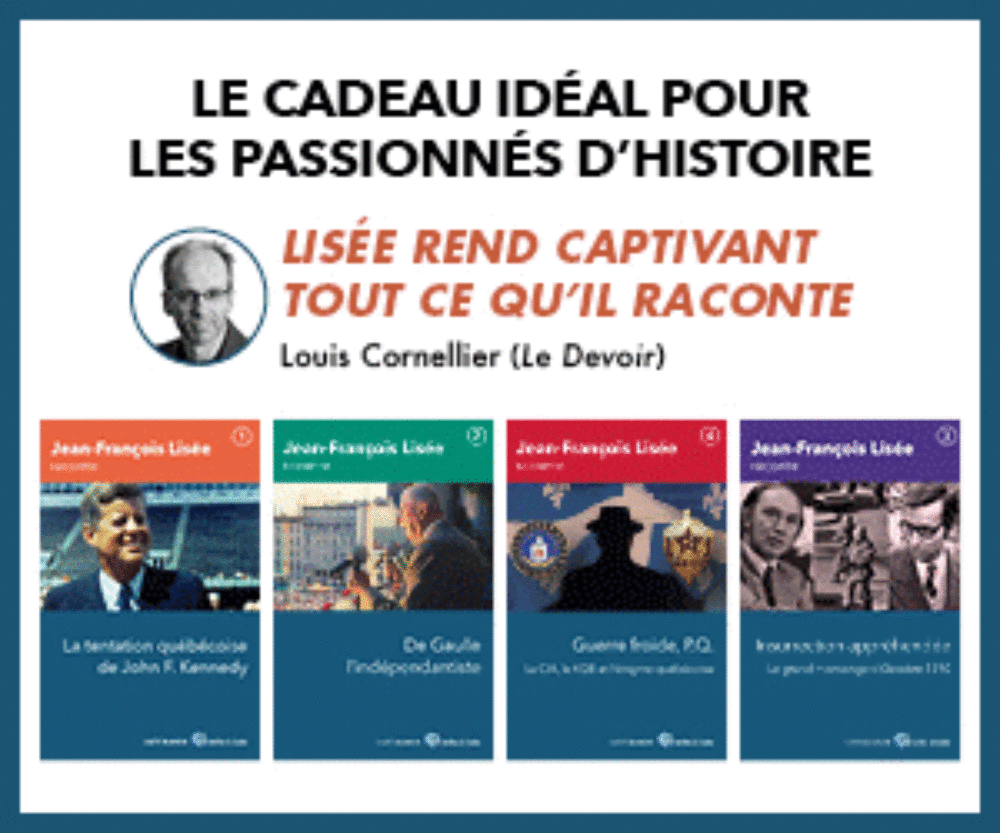


Si le refus de faire entrer les députés péquistes à l’assemblée persiste ce sera un déni de la démocratie. Peut-on alors faire-part une plainte à un organiste international?