À 36 ans, j’avais déjà beaucoup de débats derrière la cravate. Indépendantiste face à des mononcles fédéralistes, militant étudiant chantant L’Internationale, j’étais toujours partant pour une bonne discussion. Journaliste, j’avais ensuite assisté à des empoignades sévères au Québec, à Paris et à Washington.
Pourtant, lorsque j’ai assisté à ma première période de questions, à l’Assemblée nationale à l’automne 1994, je n’étais pas psychologiquement préparé au condensé d’énergie négative qui occupe ces 45 minutes d’affrontements quotidiens. Un étranger qui devrait juger de l’état de notre nation à partir des seules questions de l’opposition serait convaincu que tous les Québécois sont gravement malades et que les ministres en sont personnellement responsables, que les citoyens n’ont aucun service adéquat et sont clairement sur le point d’ériger des barricades et, surtout, que les membres du gouvernement sont, tous, non seulement des incapables, ce qui serait déjà grave, mais activement engagés dans un processus volontairement maléfique de destruction de tout ce qui est bon dans notre société.
(Une version plus courte de ce texte a été publiée dans Le Devoir.)
Tous les députés ne sont pas également experts en ce domaine mais, à l’époque, j’étais soufflé par les performances exceptionnelles de Pierre Paradis et Thomas Mulcair, des orfèvres de la mauvaise foi.
On se fait, à la longue, à ce type d’agression verbale et, le parti au pouvoir ayant pour vocation de retourner un jour dans l’opposition, les rôles s’inversent. Je me suis néanmoins demandé en quoi cette polarisation était qualitativement distincte du reste du débat public de l’époque.
(Le texte se poursuite après la pub.)

J’identifiai le procès d’intention permanent comme une caractéristique forte. Rien ne pouvait être jugé comme anodin par l’opposition. Une déclaration ambiguë était nécessairement le reflet d’une incompétence crasse. Il ne pouvait y avoir de malentendus, seulement des cover-up. Toute peccadille était par définition scandaleuse. La règle était immuable : toujours donner de chaque événement la pire interprétation possible.
Un dénominateur commun traversait (et traverse toujours) cet exercice de torture politique : ne jamais, en aucun cas, accorder à son adversaire le bénéfice du doute.
Observant aujourd’hui la teneur d’un certain nombre de nos débats, je constate que cette détestable technique s’est largement répandue. C’est crucial, car le bénéfice du doute est le lubrifiant indispensable de la civilité et du savoir-vivre. Présumer que son interlocuteur est bien intentionné et interpréter ses paroles ambiguës, jusqu’à mieux informé,comme probablement anodines ou simplement maladroitesoffre aux interactions un pare-chocs qui minimise le conflit. Considérer au contraire son interlocuteur comme nécessairement malveillant, prendre chaque remarque au pied de la lettre ou, pire, traquer l’occasion de se dire offensé produit un climat anxiogène d’affrontement général qui peut rendre intolérable la vie en société.
À qui la faute ? Aux réseaux sociaux, le suspect numéro 1. En donnant une tribune à des milliers de personnes qui, hier, déversaient leur fiel en petit comité, ils ont fait surgir dans l’espace public une intransigeance préexistante, mais auparavant inaudible. Cela a eu un effet d’entraînement en normalisant, sur Twitter et Facebook, l’insulte et l’invective. Les algorithmes polarisants en ont décuplé l’impact. Le problème est suffisamment prégnant pour qu’un logiciel créé par Microsoft en 2016 et devant avoir le comportement d’une jeune américaine de 19 ans a été retiré après 16 heures d’activité seulement. S’adaptant progressivement aux tendances observées après 40 millions d’interactions, elle était devenue raciste, misogyne et niait l’existence de l’Holocauste !
La bonne nouvelle est que seulement 11% de la population québécoise utilise Twitter et que parmi les 77% qui utilisent Facebook, une très grande proportion le font pour s’échanger des nouvelles personnelles et des photos de chatons, pas pour s’enguirlander.
Deux autres facteurs importants sont en jeu, importés de la droite et de la gauche américaine. On peut dater de l’automne 1988 le début de l’ère moderne de la publicité politique négative américaine. Une culture de l’attaque vicieuse, au besoin mensongère, a envahi l’espace occupé par les républicains, puis a essaimé au Canada, surtout anglais, balayant le respect mutuel du débat partisan, diabolisant l’adversaire, rendant tout compromis suspect.
Il faut souligner la contribution de Jean Charest à cette montée du volume au Québec. Venu des conservateurs fédéraux, il a enjoint son caucus de « détester l’adversaire », ce que je n’avais jamais entendu de notre côté. Dans l’opposition, il consacrait beaucoup d’énergie à diminuer personnellement son adversaire. Mario « la girouette » Dumont fut sa cible favorite, il tenta ensuite de définir Pauline Marois comme « vulgaire » (?!). Au pouvoir, il allait associer à la violence tout porteur de carré rouge.
De la gauche militante sont arrivés plus récemment une série de concepts apparemment imaginés pour maximiser l’opprobre. On savait ce qu’était le harcèlement sexuel. On savait ce qu’était le viol. Mais tous les comportements sexistes, du plus bénin jusqu’à l’agression caractérisée, doivent désormais faire partie de la « culture du viol ». Un continuum qui nie l’existence même de la nuance dans ce qui est répréhensible.
Plutôt que de parler de comportements racistes à éradiquer, il faut désigner la totalité des institutions comme coupables de racisme systémique. Plutôt que de promouvoir l’égalité et le respect mutuel, il faut convaincre l’ensemble des Blancs, même les plus défavorisés, qu’ils sont porteurs de privilèges. Surtout, chaque propos jugé indélicat doit être vu comme une micro-agression et dénoncé comme telle.
La spirale de l’exagération a atteint son apogée dans la lettre signée en décembre dernier par 200 auteurs, poètes, libraires et étudiants outrés que l’Association des libraires ait permis à François Legault d’indiquer sur son site qu’il avait apprécié un ouvrage de Mathieu Bock-Côté. Ils y ont vu (cramponnez-vous) « une banalisation du racisme qui donne lieu à des violences envers nos camarades racisés. Ces violences affectent l’ensemble de la société et nourrissent un climat général hostile et violent ».
Bref, le fait qu’un élu apprécie un livre dont les thèses déplaisent est assimilé à de la violence. Le bénéfice du doute, dans cet exemple, est mort et enterré. Avec lui la nuance, le sens de la mesure, le respect du désaccord, la civilité même. Ceux qui, à droite, dénoncent la « dictature sanitaire » ne font pas autre chose.
Les députés de l’Assemblée nationale savent qu’ils font du théâtre. Après la période de questions, ils se serrent la main, discutent, s’excusent même parfois d’être allés trop loin. « Ne le prends pas personnel, c’est de la politique », entend-on. Cela ne rend pas la chose plus agréable. Malheureusement, les nouveaux guerriers du débat extrême, de droite comme de gauche, ne semblent pas même conscients de l’énormité de leurs propos. Enfin, du moins, j’en ai l’impression. Car j’aimerais tant pouvoir leur laisser le bénéfice du doute.
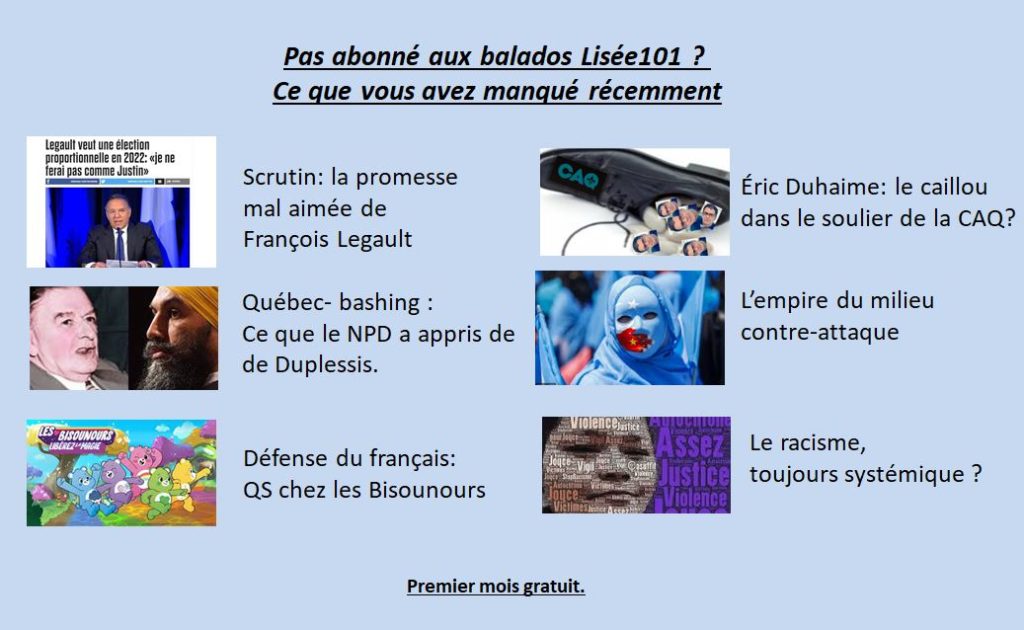


Comme à l’habitude, si complet et pertienent qu’on ne trouve rien à ajouter.
Peut-être un voeux. Que les gens fassent savoir à nos politiciens que cette très mauvaise représentation (la période de question) doit achever. Et vite.
Tellement bien écrit avec toutes les nuances nécessaires au propos!