 Robert Bourassa nage. C’est un exercice auquel il s’astreint quotidiennement, pour garder la forme. C’est aussi une cérémonie. Un rituel qu’il accomplit chaque fois que sa fonction l’oblige à un effort particulier, à une décision difficile. « Dans les moments importants, je vais nager pour dégager l’esprit de la déclaration — comme je ne lis pas de texte écrit. J’improvise d’une certaine façon, dans la forme sinon dans le fond. »
Robert Bourassa nage. C’est un exercice auquel il s’astreint quotidiennement, pour garder la forme. C’est aussi une cérémonie. Un rituel qu’il accomplit chaque fois que sa fonction l’oblige à un effort particulier, à une décision difficile. « Dans les moments importants, je vais nager pour dégager l’esprit de la déclaration — comme je ne lis pas de texte écrit. J’improvise d’une certaine façon, dans la forme sinon dans le fond. »
Les cadres du pouvoir chinois tremblaient dans leurs cols Mao chaque fois que le Grand Timonier se lançait, torse nu, dans le Yangtsé. Sa plongée annonçait invariablement une nouvelle purge, camouflée sous un mouvement de masse. À Québec, ce sont les journalistes qui guettent les baignades du premier ministre, les jours où l’histoire change de paragraphe ou de page. Aujourd’hui, sentant qu’un nouveau chapitre pourrait s’ouvrir, ils sont particulièrement fébriles.
« Quand c’est rendu que les journalistes vous attendent quand vous allez nager ! » peste le premier ministre. Ils font le pied de grue autour de l’immeuble du Club des employés civils, où se trouve la piscine, espérant lui arracher une phrase au passage. Les agents de sécurité font entrer le premier ministre par une porte dérobée. Entre deux longueurs, Bourassa cherche « la » phrase de son discours du soir. La conclusion. La formule choc. Celle qu’on citera longtemps.
Il a accepté l’idée de la proclamation [proposée par ses conseillers]. Il l’aurait peut-être eue tout seul. Maintenant il veut la tourner « de la façon la plus concise et la plus percutante possible, en préservant l’avenir, comme c’était ma responsabilité comme premier ministre ».
Joli truc. Car préserver l’avenir, en ce jour, c’est parler fort, mais sans se compromettre. Claquer une porte, sans la fermer. Robert Bourassa nage. En pleine « zone grise », dit-il. Quant au fond, « qu’est-ce qui pouvait arriver ? Il y avait pas tellement de choix : trois choix, finalement. Un qui était à rejeter, c’était : « On présente l’autre joue, on dit pas un mot. » L’autre qui était risqué, pour ne pas dire téméraire, c’était de dire : « Vous voulez pas de nous autres ? On s’en va tout seuls ! » Et le troisième choix c’était entre les deux, sans qu’on voie clairement ce que ça pouvait être à ce moment-là. À très court terme il fallait poser des gestes pour garder le contrôle de l’agenda. »
Robert Bourassa nage, mais ne plonge pas. Quant à la forme, la solution lui vient, entre deux vaguelettes. Il croit se souvenir d’une citation du chef d’État français, d’un discours livré par de Gaulle à Constantine, en Algérie, à son retour au pouvoir en 1958 ou 1959, qu’il a peut-être entendu, grâce à sa radio à ondes courtes, un soir, dans son petit appartement d’étudiant à Oxford.
Quelque chose comme « Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, l’Algérie française, aujourd’hui et pour toujours… » se souvient-il. Une façon de dire que jamais Paris n’accéderait aux demandes d’indépendance des Algériens, mais protégerait les intérêts de la minorité française en sol algérien.
De Gaulle n’a jamais prononcé cette phrase. Il a lancé à Alger son fameux « Je vous ai compris ! », volontairement trompeur. Il s’est un jour laissé aller à reprendre un slogan de la foule —Vive l’Algérie française ! — sans s’en rendre compte, a-t-il prétendu, et, ce qui est certain, alors même qu’il manœuvrait en coulisses pour mettre fin au statut colonial, donc français, de l’Algérie. L’emprunt de Bourassa ressemble bien plus dans sa forme à une citation de Proudhon : « L’État, quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, n’est, ni ne sera jamais la même chose que l’universalité des citoyens. »
Qu’importe la méprise, c’est l’intention qui compte. Le premier ministre québécois décide de s’inspirer de la forme et de l’esprit d’un mensonge pour apaiser ce soir-là son peuple meurtri.
« Ça ne vous a pas fait hésiter ? » lui-ai-je demandé.
« Ça m’a fait hésiter de dire que j’avais pris ça là. […] Je me suis dit, il y a certainement quelqu’un qui va dire : « Oui, mais, deux ans plus tard, c’était l’Algérie algérienne ! » Mais ça n’a été souligné nulle part. »
Robert Bourassa nage. Il n’hésite pas parce que l’idée de tromper son public le rend mal à l’aise. Il hésite parce qu’il craint de se faire prendre. Sorti des eaux de la rhétorique, il fait le tour de la piscine. S’assied sur les marches de l’escalier. Écrit au crayon feutre sur de petites fiches les mots qui lui sont venus à l’esprit. Esquive les journalistes à la sortie de l’immeuble, esquive les journalistes en entrant au bunker, emprunte au sous-sol le corridor qui va au parlement, et se rend jusqu’au bureau situé derrière la chambre bleue.
Là, Bourassa rumine. Répète son discours devant son proche conseiller Jean-Claude Rivest qui a le suprême privilège, dans les moments forts, d’être son premier public. Le conseiller peut voir les mots sur les fiches : « Rappeler le but de Meech, les efforts. » Il y a le mot « remercier ». Pas de phrase complète, sauf la formule choc, écrite en entier. Rivest a le droit d’écouter, pas celui de critiquer. «J’argumente pas, son affaire est faite. C’est probablement pour ça qu’il me prend, moi. » Mais s’il pressentait un désastre absolu, Rivest pourrait sonner l’alarme.
À l’Assemblée, pleine comme un œuf en ce vendredi soir, aucun ministre, aucun député ne sait comment Bourassa va présenter les choses. À l’oral, Bourassa a si rarement ému, si souvent déçu, qu’il n’a qu’à être bon pour paraître excellent. Ce soir, il sera très bon.
Il se lève, fait le rappel des événements, remercie ceux qui l’ont épaulé dans la traversée de Meech, dont, nommément, l’Ontarien David Peterson. Il évoque l’injustice faite aux Québécois, et rappelle, louangeur, le nom de René Lévesque, qui avait fait preuve, dit-il, « d’une grande flexibilité » après mai 1980, pour « réintégrer le Québec dans la constitution canadienne ». Le ton est bon, le rythme décidé. La voix claire trahit la déception.
Quelques minutes seulement, puis vient la formule pseudo-gaullienne : « Quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement. »
À cet instant, exactement, le Québec se divise en deux. Il y a ceux qui savent. Il y a ceux qui rêvent. Le récit des deux années à venir se résume, pour beaucoup, aux fluctuations de la ligne de démarcation.
* * *
Robert Bourassa, lui, sait. Il sait qu’il n’a rien dit.
« Quand je me suis assis, la réaction que j’avais c’est : « C’est fait, et il semble que ce soit bien fait. » »
L’effet produit le déroute. Autour de lui, tout le monde est debout. Les libéraux, bien sûr. Normal. Mais des péquistes, aussi. Jacques Parizeau, qui dans son propre discours l’appelle « mon premier ministre » — du jamais entendu — et lui dit « je vous tends la main » — du jamais vu —, traverse l’allée centrale pour venir le féliciter. Les applaudissements sont longs, nourris, chaleureux. Rien à voir avec «la claque» qui accompagne d’ordinaire les prestations ministérielles.
« Quand Robert Bourassa a lu son texte, se souvient un député libéral alors nationaliste modéré, Jean-Guy Saint-Roch, il y a eu un silence de mort. On a été estomaqués, puis il y a eu un sentiment d’euphorie. Moi, c’est un des rares moments où j’ai senti qu’il n’y avait plus de ligne de parti, plus d’opposition. Aujourd’hui, on lit le texte dans les gallées [Verbatim des travaux de l’Assemblée] et c’est froid. Mais si t’étais là, t’as vu le visage, le ton de la voix. On était des Québécois à ce moment-là. On est à la croisée des chemins et on y va. »
Bourassa assiste au déferlement. « C’aurait pu être des applaudissements polis. En chambre, on ne se lève pas à tout bout de champ, c’est pas la routine. Je n’avais pas écouté la radio toute la journée. Je n’étais pas sensibilisé à l’atmosphère. » Il ne s’attendait pas, en cette enceinte, à une réaction « aussi éclatante ». Au-delà des murs de l’Assemblée nationale, aussi, l’impact est, dit-il, « plus grand que je l’avais pressenti». «J’ai constaté qu’il y avait un niveau d’intérêt et d’anxiété dans la population que je n’avais pas connu depuis-certainement depuis mon retour » au pouvoir. Cherchant des exemples, il cite… la crise d’octobre de 1970, la grande grève du front commun de 1972. Mais depuis 1985, malgré la tension linguistique autour de la loi 178, il n’avait jamais retrouvé ni « senti l’anxiété presque palpable. Et c’était le cas, cette journée-là. Et le lendemain, s’il y avait quelque chose, c’était encore plus grand. »
Lorsqu’on revoit l’enregistrement de ce moment, on observe un Robert Bourassa, assis après l’effort, un peu sonné par la réaction des députés et des ministres. Hagard, comme s’il s’était réfugié dans sa carcasse et se forçait à en ressortir chaque fois qu’un collègue lui tendait la main. Puis il y retournait, le regard un peu absent. L’homme semblait débordé, dépassé.
Car il savait, lui, que le Québec ne serait pas « libre de ses choix ». Il savait, lui, que jamais il n’accepterait un verdict entraînant la province vers le statut de pays. Il savait qu’il ferait tout pour contrecarrer le choix des Québécois, alors très majoritairement indépendantistes. Et il dirait, le jour de tirer sa révérence, qu’il avait « assumé le destin du Québec ». Qu’il avait, bref, pris sur lui de décider à la place des Québécois. De leur enlever, donc, en ce point tournant, la liberté de choisir.
Cela lui a coûté, oui. La deuxième plus grande défaite de sa carrière, un référendum perdu sur des offres fédérales médiocres deux ans plus tard. Cela a fait mal.
On n’invoque le fantôme de De Gaulle qu’à ses risques et périls.
Vous voulez connaître toute l’histoire ?
Vous souhaitez une synthèse imprimée ?



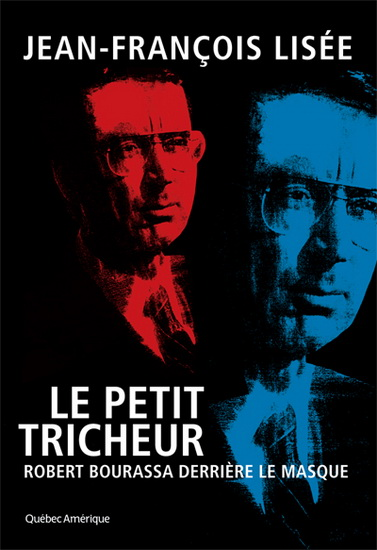
En cette veille de fête nationale, j’hésite entre : y’en aura pas de commentaire et Bourassa nage, Louise Forestier chante.
https://www.youtube.com/watch?v=CIlzMMC4rvU
En résumé, on peut dire que ce qui a manqué à Bourassa, c’est le courage. Bien dommage!