Régis Labeaume est sorti du placard. Il est indépendantiste. Bon, on savait qu’il fut naguère candidat du Parti québécois à Québec. Mais le temps passe et les convictions fluctuent. Pas pour Régis. Dans sa chronique de La Presse, il met les choses au clair. Mais il a pris en grippe Paul St-Pierre Plamondon. Ce qui est son droit le plus strict. Régis a la dent dure généreuse. Il a entamé une chronique sur le Parti libéral du Québec en annonçant : « Je serai sans coeur, mal avenant et condescendant. » Promesse tenue. Geneviève Guilbault est une de ses têtes de Turc : GG, écrit-il, « ne se prend pas pour un 7-Up flat ». Ceux qui lient la crise du logement à la vague d’immigration, comme PSPP (et les banques canadiennes), écrivait-il le 22 janvier, créent des « métastases xénophobes » et nous préparent une campagne électorale où « ça va roter du vieux sûr ».
Dans son dernier texte, Labeaume rage que St-Pierre Plamondon ose évoquer la création d’une monnaie québécoise alors que René Lévesque en 1980 et Jacques Parizeau en 1995 tenaient à conserver la canadienne. Il imagine Parizeau « expliquer les mystères de la vie à l’inconvenant », ajoute-t-il, « les deux doigts dans le nez ». Ah, mais voici, cher Régis. Et si Parizeau avait, dans l’intervalle, changé d’avis ?
D’abord, qu’est-ce qui s’est produit depuis 1995 pour qu’on puisse raisonnablement pencher pour la monnaie québécoise ? Lorsque j’ai lancé ma course au leadership en 2015, j’avais l’intuition que nos circonvolutions sur le passeport commun, la double citoyenneté, le dollar commun nuisaient, plus qu’elles n’aidaient, à notre cause. Ces questions ont chacune du mérite, mais donnaient l’impression que nous étions des indépendantistes timorés, à temps partiel.
Généraliste, j’avais constaté combien l’euro était entré en crise et ne faisait le jeu que de la locomotive allemande au détriment des pays limitrophes, incapables d’user du levier monétaire pour protéger leur économie. Bruxelles (en fait Berlin) a serré les boulons. Les ministres des Finances de chaque pays membre doivent désormais soumettre leurs budgets à la Commission européenne. Voit-on demain le ministre des Finances d’un Québec souverain faire revoir son budget à Ottawa au nom de la monnaie commune ?
On a vu aussi comment des spéculateurs se sont déchaînés pour empêcher des États d’utiliser la monnaie d’un autre, ou d’aligner la leur au dollar américain. Dans ce nouveau contexte implacable, un Québec doté du dollar canadien serait une alléchante cible. Les spéculateurs dévalueraient ses obligations pour le forcer, dans la précipitation, à créer sa monnaie. Ne serait-il pas plus sûr de suivre l’exemple de la majorité des pays du monde — dont la plupart des économies sont moins fortes que la nôtre — et d’asseoir durablement notre monnaie sur notre propre force et notre propre diversité économique ?
Au début, le scepticisme des marchés sous-évaluerait notre devise, ouvrant une période faste pour nos exportations et notre tourisme. Il n’y aurait pas que des avantages. Il faudrait surpayer pour notre part d’intérêts sur la dette canadienne. Nos importations, dont le pétrole, seraient temporairement plus chères. Avec le temps, notre monnaie se stabiliserait à sa vraie valeur.
J’avais discuté de ces questions avec deux économistes québécois de renom que je ne peux pas nommer ici (je les invite à se manifester), mais qui avait, pour l’un, tiré ces conclusions, pour l’autre, estimé que, dans le nouveau contexte, les deux options s’équivalaient. Ainsi informé, je me suis empressé de tester cette hypothèse avec M. Parizeau. Si j’annonçais publiquement cette position, puis que mon ancien patron me faisait publiquement la leçon, disons, « les deux doigts dans le nez », je serais dans de beaux draps.
Soulagement ! Il était du même avis. Il évoqua un argument de calendrier. L’Irlande, m’expliqua-t-il, avait fait son indépendance en 1922 en gardant la livre anglaise mais avait annoncé qu’elle créerait, en 1928, sa propre monnaie. Ce qui fut fait. (Sa valeur, flottante, a suivi de facto celle de la livre anglaise jusqu’en 1979.)
Il s’en était aussi ouvert à Jean-Martin Aussant, de qui il était très proche. « Nous avons discuté en long et en large de ce dossier, Monsieur et moi, quand j’écrivais la plateforme d’Option nationale en 2011 », m’a raconté Jean-Martin. Comme avec moi, M. Parizeau insistait pour procéder par étapes. « Il suggérait simplement de conserver le dollar canadien à court terme afin d’assurer une certaine continuité des affaires pendant que le Québec se concentrerait au départ à restructurer sa machine gouvernementale » en absorbant les ministères et fonctionnaires fédéraux, se souvient Jean-Martin. « Mais il laissait très clairement la porte ouverte (grande ouverte) à un État souverain qui déciderait ensuite de se doter de sa propre banque centrale, donc de sa propre monnaie. »
M. Parizeau citait les Prix Nobel James Meade (qui fut son professeur à la London School of Economics) et Robert Mundell sur les optimal currency areas (zones monétaires optimales). Pour lui, le Canada n’en était pas une pour le Québec. C’est en effet après 1995, et surtout entre 2005 et 2015, que le dollar canadien fut dopé à l’or noir, provoquant une hausse artificielle des prix des produits québécois exportés, détruisant en cinq ans 55 000 de nos emplois manufacturiers, un désastre que l’existence d’une monnaie québécoise nous aurait épargné. Parizeau, féru de politique monétaire, en était parfaitement conscient.
Les taux d’intérêt ne se décident pas en vase clos et ceux du Canada et des États-Unis influeraient sur les nôtres. M. Parizeau expliquait que notre banque centrale pourrait décider de se coller aux taux de ses voisins lorsque ce serait bon pour le Québec, ou de prendre ses distances lorsque nécessaire. C’est ce qu’on appelle, au fond, cher Régis, l’indépendance.

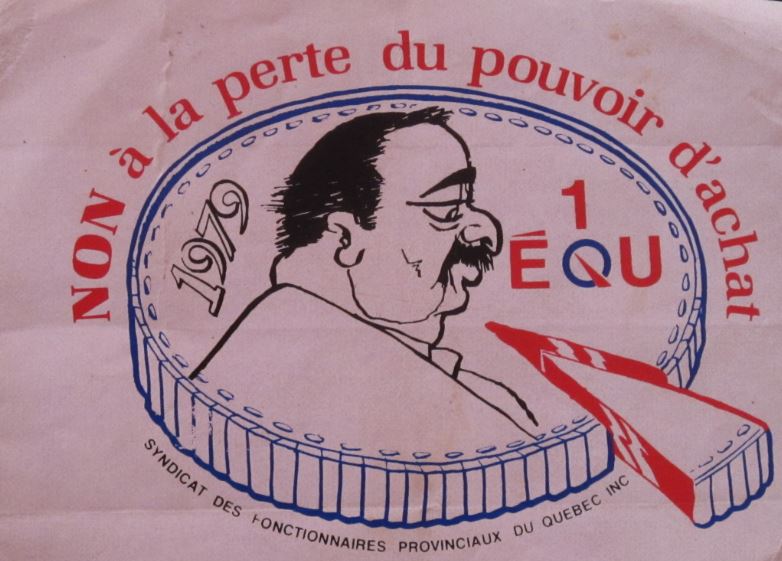
Commentaires très intéressant et très instructif, mais on n’en est pas (encore) là.
Faisons l’indépendance et alors on verra bien ce qui arrivera.
Il est très dommage que Monsieur Parizeau n’ait pas déclaré publiquement son changement de cap concernant l’utilisation de la monnaie canadienne dans un Québec souverain. Selon moi il s’agit d’une grave erreur de sa part lors de sa carrière. Une erreur étonnante étant donné sa carrure intellectuelle d’économiste financier créateur de la Caisse de dépôt et d’économiste en chef du Parti québécois. Tel qu’expliqué par le professeur d’économie publique Nicolas Marceau dans son livre, l’utilisation de la monnaie d’un autre pays par un pays soi-disant souverain empêche la possibilité de secourir les institutions financières nationales en cas de crise financière majeure comme celle de 2008. À moins, évidemment, qu’un accord de gestion commune soit trouvé entre les deux pays, ce qui impliquerait, encore une fois, un marchandage de la part du Canada en cas de victoire du oui. Un autre désavantage de ne pas avoir de monnaie nationale, rarement évoqué par les économistes, est l’impossibilité du seigneuriage, soit de se servir de la planche à billet comme mode de taxation. Il est possible également de financer certains investissements stratégiques en infrastructure avec des taux d’intérêt plus faibles que ceux du marché, ou même avec zéro intérêt. Cela est impossible sans avoir de monnaie nationale. Évidemment, la raison la plus importante pour avoir une monnaie québécoise est celle de la non optimalité de la politique monétaire canadienne pour l’économie québécoise, comme les années 2000 l’ont démontré avec une politique monétaire canadienne taillée sur mesure pour contrer l’inflation causée par la hausse du prix du pétrole, ce qui a causé des pertes d’emplois importantes au Québec. Cela est évidemment le cas pour l’Europe où tous les pays européens ont perdu leur souveraineté économique avec la création de l’euro, avec les résultats désastreux que l’on voit présentement. On fait souvent l’erreur de définir la souveraineté comme étant la possibilité de récolter 100% des taxes et impôts, de faire 100% des lois, et de faire tous les traités internationaux. Il manque à cette définition, selon moi, la capacité d’avoir une monnaie nationale…